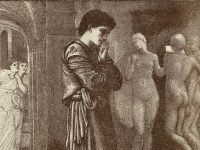Les émotions jouent un rôle clé dans nos processus décisionnels. Pourtant, jusqu’à récemment, les scientifiques ne leur ont pas accordé l’attention qu’elles méritaient. Grand spécialiste en la matière, David Sander, professeur de psychologie à l’Université de Genève, viendra en souligner l’importance le 7 février prochain à l’Université de Fribourg.
Parmi les innombrables disciplines scientifiques, les sciences affectives dont vous êtes le «chantre» ne sont pas les plus connues. De quoi s’agit-il?
La discipline des sciences affectives est en effet bien moins connue que sa grande sœur «les sciences cognitives». Une des raisons de cette méconnaissance est certainement tout simplement sa récence: les sciences affectives sont devenues un champ académique en tant que tel il y a seulement une trentaine d’années! La Suisse a été pionnière dans son développement avec la création par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, en 2005, du Pôle de Recherche National en Sciences Affectives. Même si la création des sciences affectives, comme discipline, est relativement récente, son objet d’étude fascine les plus grands penseurs depuis plus de 2000 ans!
Comment se fait-il que cette dimension émotionnelle, que je dirais presque évidente, n’ait pas été prise en compte auparavant?
En effet, l’étude des émotions et des autres phénomènes affectifs a passionné des auteurs tels qu’Aristote, Descartes ou Darwin bien avant que de nombreuses disciplines s’associent pour créer les sciences affectives. Ces dernières regroupent notamment la psychologie, la philosophie, les neurosciences, la psychiatrie, la neurologie, l’économie, l’anthropologie, la sociologie, les sciences politiques, l’histoire, la littérature, la linguistique ou encore l’informatique. Depuis plus de 2000 ans, les émotions ont été étudiées dans des cadres incluant d’autres phénomènes affectifs tels les sentiments, les préférences, les motivations, les humeurs, les passions, les styles affectifs, les désirs ou encore les pulsions. L’analyse des émotions en tant que phénomènes psychologiques, corporels et sociaux date au moins de l’Antiquité. Je dirais que le changement récent provient d’au moins trois sources:
- Tout d’abord, au niveau théorique, on a longtemps opposé cognition et émotion, probablement à cause du débat classique entre raison et passion. Mais les recherches actuelles montrent que cette opposition n’est pas justifiée.
- Ensuite, il y a eu des développements méthodologiques dans de nombreuses disciplines qui permettent de mieux étudier expérimentalement les émotions. Par exemple, les développements spectaculaires de la neuroimagerie dans les années 1990 permettent d’étudier les bases cérébrales des émotions tel que cela était impensable il y a encore 50 ans.
- Finalement, je dirais qu’il y a un courant de pensée actuelle, que nous avons appelé l’affectivisme, qui démontre que les émotions sont utiles pour mieux comprendre, non seulement les processus affectifs, mais également le comportement et la cognition.
Dans quelle mesure nos émotions influencent-elles notre attention, notre mémoire et nos décisions?
Les émotions influencent ces mécanismes «pour le meilleur et pour le pire». Elles constituent en fait des réponses à des situations internes, comme des souvenirs, ou externes, comme par exemple une odeur, une musique ou une scène visuelle. Les informations les plus émotionnelles sont triées de manière prioritaire et sont aussi mieux encodés, mieux mémorisés que celles dont la charge émotionnelle est moindre. Nous pensons que la modulation de l’hippocampe (qui est une région très importante pour la mémoire épisodique) par l’amygdale (qui est une région très importante pour les émotions) favorisent ce mécanisme. Puisque nos émotions ont le potentiel d’attribuer une valeur affective à chacune des options d’une prise de décision, nous utilisons nos émotions pour faire des choix dans tous les domaines de notre vie, aussi bien lorsqu’il s’agit de décider de ce que l’on va manger que de décider pour qui l’on va voter.
A un niveau personnel, est-ce que votre propre perception des émotions a évolué grâce à vos recherches?
Oui! Je considère les émotions, celles des autres et les miennes, de manière beaucoup plus sérieuse qu’avant en tant que sources d’informations utiles. Les émotions authentiques étant des réponses fonctionnelles à l’environnement, elles nous informent sur ce qui est important pour nous et sur ce qui est important pour les personnes autour de nous. Sachant à quel point elles guident notre comportement et notre cognition, je me demande souvent quelle émotion je ressens ou quelle émotion quelqu’un d’autre ressent et si cette émotion est justifiée.
Au terme de votre conférence, si les participant·e·s ne devaient retenir qu’un seul message. Quel serait-il?
Ce message serait le suivant: les émotions sont souvent rationnelles et elles ne s’opposent pas à la cognition. Ce message peut surprendre, mais je pense qu’il est important de se rendre compte que ni notre esprit ni notre cerveau ne sont «coupés en deux» avec, d’un côté, des processus émotionnels qui seraient irrationnels et, de l’autre, des processus cognitifs qui seraient rationnels. Prenez un exemple très simple: face à un danger imminent, il est rationnel d’avoir peur: l’organisme va rapidement se préparer à réagir face à ce danger (par exemple en fuyant). Notre expression faciale et vocale de peur permet même d’alerter d’autres membres de notre groupe à propos du danger. Une réaction irrationnelle face à un danger serait justement de ne pas avoir peur! Mais la peur peut également être irrationnelle, par exemple quand il n’y a pas de raison d’évaluer la situation comme dangereuse. Une émotion justifiée nous aide à adopter un comportement adapté en mobilisant de nombreux processus cognitifs.
- Emotions et polyhandicap: s’é-mouvoir ensemble, Journée d’études, Ouvert au grand public, 07.02.2025, 09:30 – 16:30
- Délai officiel d’inscription au 3 février (possibilité de s’inscrire sur place)
- Centre suisse des sciences affectives
- Laboratoire pour l’étude des émotions
- Les villes européennes, actrices de l’histoire - 02.04.2025
- Une thèse en guise de sésame vers la vie professionnelle - 31.03.2025
- Une station de ski trop belle pour être vraie - 27.03.2025