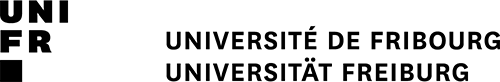Le parcours intellectuel
(J.-P. Torrell, Fribourg, 20.04.2016)
À le regarder de l’extérieur, mon parcours intellectuel est plutôt fait pour me couvrir de confusion. J’ai fait mon apparition dans le monde théologique comme spécialiste du premier concile du Vatican, sur lequel j’ai publié un livre et quelques articles. Puis on m’a retrouvé comme chroniqueur de théologie fondamentale de la Revue thomiste. Mais c’est alors aussi que j’ai commencé à être connu pour mes travaux sur la théorie de la prophétie au Moyen Âge et sur Pierre le Vénérable. Chemin faisant, on m’a retrouvé à la Commission Léonine pour l’édition critique des œuvres de Thomas d’Aquin, puis à l’université de Fribourg où j’ai enseigné pendant près de vingt ans la théologie dogmatique (Église, christologie, sotériologie, mariologie et divers autres sujets). C’est alors que je suis revenu à saint Thomas et que j’ai publié depuis quelques années plusieurs livres sur son œuvre. Tout cela se reflète dans ma bibliographie. Un observateur bienveillant qui ne connaîtrait que cette liste de publications pourrait parler gentiment d’un aimable éclectisme. S’il est plus sévère, il pourrait aussi me taxer de papillonnage… À regarder les choses de l’intérieur toutefois, il y a tout de même quelques explications et même peut-être un semblant de raison à ce parcours multiple.
Je suis un tard venu à la vie intellectuelle. Après avoir terminé l’école primaire, j’ai gagné ma vie en travaillant comme jardinier maraîcher dans la petite exploitation familiale, de 14 ans à 25 ans. Après mon service militaire, avec l’aide du curé de ma paroisse, j’ai commencé à faire quelques études et, tout en continuant à travailler de mes mains, j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires (le baccalauréat) à l’été de 1951. Je suis entré quelques mois plus tard au noviciat de la Province dominicaine de Toulouse, en janvier 1952. J’avais alors 25 ans. J’ai accompli les sept années d’études institutionnelles à l’école de saint Thomas : à Saint-Maximin d’abord (1952-1957), puis à Toulouse (1957-1959), avec comme maîtres principaux le P. Marie-Michel Labourdette en théologie morale et le P. Marie-Vincent Leroy en théologie dogmatique. Grâce à la présence au Studium de deux condisciples passionnés de la Bible (Jean-Luc Vesco notamment), j’ai aussi moi-même beaucoup travaillé la Bible.
Ce premier cycle d’études s’est conclu avec l’année scolaire 1958-1959. Sous la direction du P. Leroy, j’ai obtenu le grade de Lecteur dans l’ordre dominicain. Jusqu’au Code de Droit Canonique de 1917, le lectorat en philosophie et théologie, considéré comme l’équivalent de la Licence canonique en théologie, permettait d’enseigner dans les Facultés ecclésiastiques (c’était le seul titre de la plupart de mes maîtres). Mais les choses commençaient à changer et les jeunes dominicains devaient en outre obtenir la licence. J’ai donc préparé les deux examens simultanément et j’ai obtenu le lectorat au Studium dominicain et la licence à l’Institut catholique de Toulouse, en 1959. Comme dissertation écrite pour ces deux examens, j’ai travaillé la notion de Sacra Doctrina chez Thomas d’Aquin. C’est alors que j’ai découvert les travaux de Marie-Dominique Chenu et d’Yves Congar sur ce thème et je reconnais que je leur dois beaucoup. Déjà à cette époque j’étais préoccupé par la dimension spirituelle de la théologie et je me suis efforcé de mettre en évidence les implications augustiniennes et affectives de la théologie de saint Thomas. C’est de ce moment-là que date mon intérêt pour la méthode en théologie et j’y suis souvent revenu par la suite.
Au moment de mes études plus spécialisées en vue du Doctorat, mes supérieurs m’ont demandé de me préparer pour l’enseignement de l’ecclésiologie et me proposaient d’aller soit à Rome, à l’Angelicum, soit au Saulchoir, près de Paris. Le maître incontesté en ecclésiologie dans le monde francophone de l’époque était le P. Yves Congar, j’ai donc opté pour Le Saulchoir. Mais puisque Congar était encore interdit d’enseignement, j’ai donc fait mon doctorat sous la direction du P. Jérôme Hamer, qui deviendra plus tard cardinal, et qui était déjà bien connu dans le domaine de la théologie de l’Église. À ce moment-là, il était aussi le régent du Saulchoir et je n’ai eu qu’à me féliciter d’avoir travaillé sous sa direction.
Je suis arrivé au Saulchoir d’Étiolles en octobre 1959. C’était juste le moment où Jean XXIII convoquait le concile du Vatican II, dont tout le monde disait qu’il reprendrait l’œuvre inachevée du précédent concile. Le P. Hamer me suggéra donc de travailler sur la théologie de l’épiscopat de Vatican I. Le sujet était bien délimité, j’ai donc pu progresser rapidement. Le moment était aussi favorable et je n’ai eu aucun mal à publier ma thèse, dès 1961, dans la collection « Unam Sanctam » (sur la recommandation du P. Congar, bien sûr, qui m’avait d’ailleurs fait bénéficier de ses conseils).
De retour à Toulouse, en février 1961, j’ai donc enseigné l’ecclésiologie. Tant bien que mal ! je dois dire, car j’avais encore tout à apprendre. C’était le premier cours d’ecclésiologie qui se donnait alors au Studium. Mais Dieu merci ! outre les travaux de Congar, il y avait ceux de Charles Journet et d’Henri de Lubac ; ce sont aussi des maîtres qui m’ont beaucoup apporté. Simultanément, j’ai dû également enseigner la théologie fondamentale, avec un intérêt particulier pour la théologie de la Tradition (encore une influence congarienne) et pour la théologie de la Révélation (là, je dois beaucoup au P. Ambroise Gardeil).
Naturellement, comme tout jeune dominicain, en plus des cours, j’ai dû faire face aux requêtes d’un ministère assez prenant : prédications, retraites, sessions… À cette époque, j’ai fait énormément de sessions de recyclage pour les prêtres en vue de faire connaître l’enseignement de Vatican II. J’ai donné aussi beaucoup de sessions et de retraites pour les religieuses dominicaines et d’autres, puisque j’ai été conseiller théologique de leur Groupement fraternel pendant quatre ans. J’étais en plus directeur du Studium des religieuses à l’Institut saint Thomas d’Aquin, qui était alors une grosse affaire avec plus de 100 étudiantes chaque année. Tout cela ne laissait guère de temps pour le travail intellectuel et le peu de loisir que je pouvais dégager passait à la rédaction de mes chroniques de théologie fondamentale. J’ai occupé ce poste de chroniqueur pendant quelque vingt ans et cela m’a donné l’occasion d’apprendre beaucoup de choses. Mais ces dix années de travail échevelé m’avaient laissé complètement épuisé. Je pensais donc sérieusement à décrocher. Aussi, dès que j’en ai eu la possibilité, j’ai demandé à prendre un congé sabbatique.
Déjà à cette époque (dans les années 60) s’est produit un premier glissement dans mon parcours intellectuel. L’actualité de Vatican II a rapidement repoussé dans l’ombre le Vatican I de ma thèse. C’est plutôt Dei Verbum et la théologie de la Révélation et de la Tradition qui m’intéressaient alors. Dans la ligne de mes recherches sur Écriture et Tradition, j’avais donc d’abord pensé aller travailler à l’Institut œcuménique récemment fondé à Tantur, près de Jérusalem, et j’avais reçu un accueil très favorable de Charles Moeller, qui en était le directeur à l’époque. Malheureusement, il n’y avait aucune possibilité de financement de ce côté-là. J’ai donc dû abandonner cette piste et chercher ailleurs.
Il se trouvait aussi que l’étude de la théologie de la Révélation m’avait amené à faire quelques recherches sur la connaissance prophétique, dans la Bible bien sûr, mais aussi chez saint Thomas. L’expérience prophétique m’est très vite apparue en effet comme le lieu par excellence où s’est produite la Révélation en acte (je me suis aperçu à ce moment-là que ç’avait été aussi l’intuition du jeune Alfred Loisy). C’est alors que j’ai découvert que Thomas avait lui-même beaucoup reçu de deux auteurs de langue arabe très célèbres dans l’histoire de la pensée médiévale : le musulman Avicenne et le juif Maïmonide. Conseillé sur la filière par des amis, j’ai demandé et obtenu une bourse du CNRS canadien pour travailler les sources arabes et juives du traité de la prophétie de la Somme de théologie. Mais en essayant d’établir la bibliographie du sujet, je n’ai pas tardé à m’apercevoir que ce thème avait déjà été étudié, et même très bien, par Bruno Decker, qui lui avait consacré une thèse remarquable. J’ai donc dû changer mon fusil d’épaule et j’ai travaillé pendant deux ans (de 1971 à 1973) sur des textes inédits concernant la théorie de la prophétie chez les prédécesseurs de saint Thomas. C’est de ce moment-là que datent mes recherches plus poussées sur la prophétie et sur l’époque qui précède la grande scolastique. Du même coup c’était également le début de ma spécialisation de médiéviste.
L’essentiel de mon travail a été recueilli dans ma thèse sur Hugues de Saint-Cher qui a été le résultat de mon repos sabbatique, mais il y a eu quelques retombées en plusieurs articles complémentaires, qui ont été rassemblés plus tard dans un volume de la collection « Dokimion ». Je n’ai jamais d’ailleurs tout à fait arrêté ces recherches sur la prophétie et j’ai publié récemment deux autres travaux : une nouvelle édition du volume sur la prophétie de saint Thomas dans la « Revue des Jeunes » (au Cerf) ; une traduction annotée de la question De prophetia du De veritate, chez Vrin (en collaboration avec Serge-Thomas Bonino). Je pense que ce sont les derniers volumes que je consacrerai à ce sujet, mais j’ai été assez amusé de retrouver ces deux livres 35 ans plus tard, en finale de mon parcours, alors que mon premier projet avait été de commencer par eux. Il faut parfois une certaine persévérance dans la vie… Quant à l’intérêt pour la période précédant saint Thomas, il s’est aussi concrétisé par la publication en 2002 de mes recherches sur Guerric de Saint-Quentin en introduction à l’édition des Quodlibets faite par mon ami regretté Walter Principe.
Mais là, je viens d’anticiper. Si je reprends l’ordre historique, c’est aussi à cette même époque (1973), quand j’étais encore à Montréal, que sont apparues simultanément deux nouvelles orientations. À l’origine de la première il y a eu une amie de longue date, Denise Bouthillier. Elle préparait alors une thèse sur Pierre le Vénérable. Non seulement, elle m’a fait connaître cet auteur si attachant, mais connaissant mes centres d’intérêt, elle m’a généreusement donné tout un matériel dont elle n’avait pas l’usage pour sa thèse, sur l’Église et la prophétie chez cet abbé de Cluny. C’est ainsi que je me suis retrouvé en possession d’un certain nombre de fiches sur ces deux sujets et je n’ai eu qu’à compléter cette documentation pour en faire quelques petites publications. C’est aussi à ce moment-là qu’est né le projet d’une collaboration entre nous, qui s’est soldée par quelques livres et quelques articles de plus – signés de nos deux noms désormais. Nous avons ainsi travaillé en collaboration pendant un peu plus de dix ans, mais depuis vingt ans, nous avons dû abandonner ce chantier (je vais expliquer pourquoi) et elle-même se retrouve maintenant en train de travailler pour la Commission Léonine au Catalogue des manuscrits des œuvres de saint Thomas. Elle continue d’ailleurs à m’aider à titre amical pendant les vacances d’été pour mes propres travaux.
La deuxième orientation s’est manifestée elle aussi en cette même année 1973. Dans le petit monde des médiévistes, les nouvelles se transmettent très vite. Quand les gens de la Commission Léonine ont su qu’il y avait à Montréal un dominicain qui travaillait sur Hugues de Saint-Cher, ils n’ont pas tardé à me contacter pour me proposer de les rejoindre : officieusement d’abord par la plume du P. Bertrand-Georges Guyot, très officiellement ensuite par la voix du P. Pierre-Marie de Contenson, directeur de la Commission à cette époque. Mon Provincial, le P. Joseph Kopf, contacté lui aussi, me laissait libre. Je dois dire honnêtement que cela a été pour moi un vrai dilemme. L’idée d’abandonner le ministère de contact direct, varié et enrichissant, que j’avais connu jusqu’alors, pour aller m’ensevelir à Grottaferrata, en Italie, et m’escrimer sur des microfilms de vieux grimoires, n’avait rien de très excitant… Par ailleurs, j’étais aussi très conscient que si je reprenais la même vie de ministère surchargée que j’avais auparavant, je pouvais faire une croix sur toute ambition intellectuelle, si mince soit-elle. En toute humilité, je ne me sentais pas le droit de renoncer à une vocation intellectuelle. J’ai donc choisi la voie du travail scientifique. Je ne l’ai évidemment jamais regretté, car j’ai trouvé à Grottaferrata, avec B.-G. Guyot, Louis Bataillon, René-Antoine Gauthier surtout, mais aussi avec les franciscains : Ignatius Brady, Cesare Cenci, Guy Bougerol, Jérôme Poulenc, des personnes d’une compétence exceptionnelle qui constituaient un milieu de travail très stimulant. J’ai pu nouer avec certains d’entre eux des liens fraternels qui me sont très précieux. La vie à la Léonine ne se distingue pas tellement par un foisonnement d’évènements prestigieux à longueur de journée. Je n’ai donc pas grand-chose à dire des huit ans que j’y ai passés, sinon que j’ai dû apprendre comme tout le monde à déchiffrer patiemment les rudiments du métier (paléographie, collation des manuscrits, construction d’un stemma, etc.). J’ai pourtant réussi à éditer quelques petits textes (le De Decem preceptis, le De Prophetia de saint Albert, celui d’un anonyme bonaventurien) qui ont été publiés dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques. J’ai aussi mis en train l’édition du Commentaire du Livre I des Sentences. J’ai même fait quelques autres petites choses à côté : pour me reposer de la collation des textes de saint Thomas, je continuais à travailler Pierre le Vénérable ; j’ai aussi donné un cours semestriel doctoral à l’université grégorienne pendant huit ans sur des sujets choisis de théologie fondamentale et d’ecclésiologie. J’ai été très bien accueilli à la Grégorienne, notamment par le P. René Latourelle, un ami de longue date.
Je viens de le dire, la vie commune entre dominicains et franciscains était très agréable à Grottaferrata. Si je joins à cela quelques excursions qui m’ont permis de découvrir les splendeurs de l’Italie, je peux dire que j’étais un homme heureux de mon sort. Mais c’est justement lorsque je pensais avoir trouvé mon orientation définitive… Au moment même où je commençais à être en possession de ma nouvelle spécialité et où je venais de mettre en train le travail d’édition du premier Livre des Sentences, qui devait m’occuper au minimum pendant vingt ans… Ou, si l’on préfère, au moment où j’arrivais à l’âge qui aurait dû être celui de la retraite si j’avais été cadre dans une entreprise quelconque… C’est précisément à ce moment-là qu’est survenu un nouveau changement de direction tout à fait inattendu. Le P. de Couesnongle, alors Maître de l’ordre, a fait lui-même le déplacement de Rome à Grottaferrata pour me dire qu’il souhaitait me voir reprendre le service de l’enseignement à Fribourg. Il me demandait donc de poser ma candidature à la succession du P. Jean-Hervé Nicolas comme professeur de théologie dogmatique.
Pour dire vrai, ce n’était pas mon vœu le plus profond. Mais je me suis présenté par obéissance à mon supérieur et il se trouve que j’ai remporté le concours. Rétrospectivement, je ne regrette pas d’avoir accepté ce poste. J’ai eu la grande chance d’avoir des auditoires nombreux et d’origine internationale variée. Ces contacts ont été très enrichissants. J’ai surtout eu l’occasion de travailler avec beaucoup d’étudiants doués, dont certains sont même exceptionnels. Plusieurs de leurs travaux ont été publiés dans de prestigieuses collections de théologie historique. Au point de vue matériel, j’ai eu des facilités de travail que je n’avais jamais connues et que je n’aurais probablement pas eues ailleurs. Cela m’a permis de poursuivre mes recherches et mes publications dans des conditions idéales.
Je suis arrivé à Fribourg en 1981. L’enseignement de l’ecclésiologie n’était pas nouveau pour moi, mais j’ai dû bâtir un cours de christologie. Cela m’a demandé beaucoup de travail, mais cela m’a aussi beaucoup appris quant au mouvement contemporain des idées. J’ai dû également enseigner diverses autres matières dans le cadre des cours spéciaux et des séminaires. Je vous en passe la liste. Quant au travail personnel – et grâce à un subside du Fonds national suisse pour la recherche scientifique renouvelé pendant six ans –, nous avons terminé avec Denise Bouthillier plusieurs choses qui étaient en train sur Pierre le Vénérable et nous avions même commencé un nouveau livre. Mais c’est alors qu’une sollicitation s’est présentée qui allait changer la donne une nouvelle fois.
En 1986, le P. Aimé Solignac, jésuite, directeur à l’époque du Dictionnaire de spiritualité, me demandait d’écrire pour lui l’article sur saint Thomas et sa spiritualité. Ce n’était pas une petite affaire. Comme j’étais déjà engagé dans d’autres travaux, mon premier mouvement a donc été de refuser. Mais le P. Solignac a su utiliser un argument qui m’a contraint à réfléchir : « Vous appartenez à la dernière génération qui a fait toute sa théologie en suivant pas à pas le texte de la Somme ; il est important de transmettre ce savoir-faire avant qu’il ne soit trop tard. » J’en ai parlé avec ma collaboratrice puisque nous travaillions ensemble à ce moment-là dans le cadre du projet du Fonds national suisse, et ensemble nous avons consulté Dom Jean Leclercq, le célèbre bénédictin de l’abbaye de Clervaux, avec qui nous étions en relations pour nos travaux sur Pierre le Vénérable. Cela m’a beaucoup frappé ; il a été formel : il faut accepter cette proposition.
Nous avons donc terminé ce qui était en cours sur Pierre le Vénérable et je me suis mis en devoir de rassembler la documentation nécessaire pour cet article du Dictionnaire. Mes amis de la Léonine m’ont alors beaucoup aidé (le P. Gauthier et le P. Bataillon en premier lieu). Au bout de quatre ans, j’avais écrit l’équivalent de cent colonnes. C’était naturellement beaucoup trop. Le P. Solignac en a tout de même publié cinquante et il me suggérait de faire un livre avec ce qui restait. C’est ce que j’ai fait. Mais au lieu d’un livre, j’en ai fait deux : « Initiation à saint Thomas » (1993), qui aborde la vie et les œuvres sous l’aspect plutôt historique, et « Saint Thomas maître spirituel » (1996), qui propose les idées maîtresses de sa pensée du point de vue de leur prolongement dans la vie chrétienne. Il faut croire que ces livres répondaient à une certaine attente. On en a vendu beaucoup et ils ont été traduits en plusieurs langues (allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, portugais, hongrois). Aux États-Unis notamment on a déjà fait une nouvelle édition et l’accueil semble avoir été très favorable. En Italie, on a même fait une deuxième traduction. Les deux volumes, déjà sensiblement augmentés, ont été réédités en 2002. L’« Initiation », qui a fait l’objet d’une nouvelle édition considérablement remaniée pour tenir compte des plus récentes avancées de la recherche, est sortie en octobre 2015. Il en ira de même pour « Maître spirituel » dont la publication devrait intervenir sous peu (fin 2016).
On l’aura remarqué, une bonne partie de mes livres portent sur la christologie. C’est assez normal, puisque c’était une des matières principales de mon enseignement mais, une fois encore, une impulsion extérieure est intervenue. En 1989 – dans le cadre de la Journée thomiste qui a lieu tous les ans, en décembre, à Saint-Jacques, à Paris – j’avais dû faire un exposé sur la place du Christ dans la spiritualité de saint Thomas. Il y avait dans l’auditoire Joseph Doré, devenu archevêque de Strasbourg, qui était à l’époque doyen de la Faculté de théologie à l’Institut catholique de Paris. Intéressé par ma présentation, il m’a demandé de lui écrire quelque chose pour sa collection « Jésus et Jésus-Christ ». Il m’a fallu attendre dix ans avant d’avoir le loisir nécessaire pour cela, mais « Le Christ en ses mystères » est enfin paru en 1999. Là-dessus s’est greffée l’initiative du Cerf de rééditer la traduction de la Somme dans l’édition de la « Revue des Jeunes » et c’est ainsi que j’ai été amené à refaire les anciennes traductions et annotations du P. Héris pour « Le Verbe incarné », et du P. Synave pour « La vie de Jésus » (que j’ai d’ailleurs rebaptisée : « Le Verbe incarné en ses mystères »). Cela donne un total de huit volumes pour la christologie de la Somme. Pour faciliter la consultation, cet ensemble a été réuni un peu plus tard en un seul gros volume intitulé « Encyclopédie. Jésus le Christ chez saint Thomas d’Aquin », paru en 2008.
Parmi les avantages de l’âge (car il y en a), il y a celui de la retraite. Si l’on a la chance d’y arriver en relative bonne santé, on a enfin le temps de “travailler”. Cela semble paradoxal, car la plupart des gens prennent alors des vacances, mais ceux qui sont parvenus à cette situation me comprendront. J’ai certes aimé l’enseignement et j’ai éprouvé la joie que l’on ressent à transmettre des choses que l’on aime et à éveiller de nouveaux talents, mais cela s’accompagne d’un bon nombre d’obligations universitaires qui ne sont pas toutes passionnantes. Lorsqu’on s’en est dégagé, on a désormais son temps libre pour des travaux personnels trop longtemps différés. J’ai donc entrepris une œuvre de divulgation dans un double domaine. Le premier consiste à faire connaître une partie de l’œuvre de saint Thomas demeurée jusqu’ici trop peu connue. À la suggestion de mes collègues, j’ai commencé par une traduction commentée du « Compendium Theologiae », parue en 2007, sous le titre « Abrégé de Théologie », qui est en effet un livre précieux pour l’étude de la pensée thomasienne. Toujours sollicité par les confrères, j’ai continué par un autre volume de traductions commentées qui porte le titre « La Perfection, c’est la charité ». Il s’agit de trois livres écrits par Thomas en défense de la vie religieuse mendiante, franciscains et dominicains, contre les Maîtres séculiers de l’université de Paris qui étaient résolument opposés à ces nouveaux venus. Il serait trop long de détailler le contenu de ces livres, mais il faut au moins savoir que l’un d’eux, « La Perfection de la vie spirituelle », est un petit chef d’œuvre, indispensable à quiconque souhaite savoir ce qu’est la vie chrétienne à l’école du Maître d’Aquin. Si l’on joint à ces deux volumes la traduction des quelque vingt « Sermons » qui nous sont parvenus, et les « Sermons sur les dix commandements », on aura l’essentiel de ces œuvres méconnues que je souhaitais rendre accessibles à un plus large public.
Le deuxième grand domaine dans lequel j’ai pu travailler quelque peu dans ma retraite studieuse se subdivise lui aussi selon deux préoccupations principales. La première consiste en un retour à l’origine de ce qui est resté mon souci fondamental, mon interrogation de toujours sur la portée spirituelle de la théologie. C’est cela qui a motivé quelques livres de méditations écrites ou orales et de prédications. Les titres parlent d’eux-mêmes : « Inutile sainteté ? », « Dieu qui es-tu ? », « La Parole et la voix », « La Splendeur des saints », « La Croix glorieuse »… Ma deuxième préoccupation se résume au désir d’étendre à un public plus vaste l’enseignement dispensé aux étudiants de Fribourg sur un certain nombre de sujets : « Un peuple sacerdotal. Sacerdoce baptismal et ministère sacerdotal », « Résurrection de Jésus et résurrection des morts », « Pour nous les hommes et pour notre salut. Jésus notre Rédemption », « La Vierge Marie dans la foi catholique »… Il reste beaucoup à faire, mais à chaque jour suffit sa peine.
Voilà pour l’essentiel de mon parcours intellectuel. On aurait pu ajouter bien d’autres choses, mais je n’ai pas voulu entrer dans trop de détails. Avant de terminer, j’aimerais revenir un instant sur l’impression d’éparpillement que j’évoquais en commençant. En réalité, sans vouloir faire un plaidoyer pro domo, je ne vois guère que l’épisode Pierre le Vénérable qui pourrait à la rigueur justifier ce jugement. Il m’a pourtant été des plus utiles pour ma culture de médiéviste. Quant au reste, je dois constater que volens nolens mes travaux se sont développés autour d’un axe central qui a toujours été saint Thomas. Je prends seulement deux exemples. Mes travaux sur la prophétie ont été motivés par le souci de mieux connaître les sources de Thomas, et j’ai pu constater une fois de plus, avec mes deux derniers livres sur ce sujet, à quel point son dialogue avec la philosophie arabe et juive est une réalité trop négligée par les théologiens (les philosophes universitaires sont plus avisés). Quant à la dimension spirituelle de la doctrine thomasienne, loin d’être un repentir tardif, elle a été le sujet de ma thèse de lectorat – le premier travail que j’aie jamais écrit ! Je suis donc revenu tout simplement à mes premières amours. J’ose espérer seulement que ce que j’écris maintenant est un peu moins rudimentaire que ce que j’avais fait alors. En effet, il faut le dire, mon passage par Le Saulchoir et par la Commission Léonine a été décisif pour m’apprendre une certaine rigueur scientifique et l’exigence de la critique historique et textuelle dans le traitement de la doctrine elle-même. Quant au reste, ce qui ne se rattache pas directement à cet axe central – et cela recouvre beaucoup de choses ! – ce sont des aléas historiques, imposés par l’obéissance religieuse. Obéissance aux supérieurs ou aux évènements. J’ai dû apprendre comme tout le monde que, même dans une vie en apparence toute unie, si Dieu écrit droit, c’est au moyen de lignes courbes.
Jean-Pierre Torrell O.P.
Professeur émérite
20 avril 2016