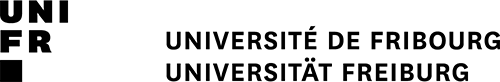Appel à communicationPublikationsdatum 09.06.2025
Mettre en musique l'innovation : de la célébration à la parodie
Mettre en musique l’innovation, de la célébration à la parodie
Un dialogue entre cérémonies officielles et scènes musicales, 1840-1940
3-4 novembre 2025
Haute école de musique de Genève et Université de Fribourg
L’essor des expositions universelles au milieu du XIXe siècle émane de la volonté des nations de promouvoir leurs traditions séculaires tout en présentant les nouveautés technologiques offertes par la société industrielle. La musique occupe dans cette équation une fonction ambivalente. Elle est à la fois le vecteur d’une évolution artistique mise en parallèle avec les avancées technologiques et l’expression d’un art prestigieux du passé considéré comme une substance culturelle nationale.
Les oeuvres composées pour célébrer le progrès technique occupent une place privilégiée dans plusieurs manifestations officielles ou solennelles. En France, l’exemple bien connu du Chant des chemins de fer d’Hector Berlioz, commandé en 1846 pour l’inauguration des Chemins de fer du Nord à Lille, est la première oeuvre à sujet technologique composé pour une manifestation officielle. Pour l’Exposition universelle de 1867, un concours récompense une cantate célébrant l’aboutissement de l’humanité technologique – Les noces de Prométhée, dont la partition de Camille Saint-Saëns sort vainqueure. Le même compositeur donne voix au triomphe de l’électricité lors de l’Exposition de 1900, avec sa cantate Le feu céleste. Pour finir, lors d’une soirée de gala organisée par l’Aéro-club de France en 1911 à l’Opéra de Paris, le compositeur amateur, mécène et pétrolier Henry Deutsch de la Meurthe présente le premier opéra à sujet aéronautique, Icare.
Ces oeuvres s’articulent souvent comme des tours de force de compositeurs qui, tout en peignant la grandeur de la création humaine, exposent leur savoir-faire. Les excès qui en découlent ont tôt fait d’engendrer des parodies, ridiculisant le discours officiel, tout en exploitant à loisir certains effets pour le plus grand bonheur d’un public avide d’artifices. Ces oeuvres satiriques tiennent le rôle de contrepied comique à l’esthétique pompeuse de la production musicale des cérémonies ou des expositions, à tel point qu’il est difficile de considérer le langage des cantates officielles sans tenir compte de leur détournement parodique. Par exemple, lorsque le cadet des frères Ricci, Federico, doit composer un opéra pour les Bouffes-parisiens en 1872, il adopte l’humour satirique à la Offenbach mettant en musique un « sextuor de la pile électrique ». Un parlante effréné, issu de la tradition italienne, prend possession des personnages pour dépeindre une énergie déshumanisante. De même, dans l’opérette The Arcadians de Lionel Monckton et Howard Talbot, présenté avec succès en 1909 au Shaftesbury Theatre de Londres, l’apparition d’un avion vient perturber, par un épanchement chromatique « sophistiqué », le climat diatonique et naïf de l’Arcadie.
Le sujet même de la technologie se prête d’ailleurs à un traitement musical parodique. Les exemples sont nombreux où la technologie sert de prétexte pour une écriture musicale fragmentaire, répétitive voire bruitiste qui défie les normes et pave la voie au développement d’un langage valorisant le rythme et la stratification : du Petit train de plaisir, comique-imitatif de Gioachino Rossini, avec son « sifflet satanique » et sa « douce mélodie du frein », au dialogue avec le moteur (un roulement de grosse caisse insensible aux mots doux de l’aviateur) dans Der Lindberghflug de Bertold Brecht, Paul Hindemith et Kurt Weill.
Buts du colloque
Ce colloque international propose une lecture transnationale de la représentation musicale des innovations technologiques. En mettant en dialogue les manifestations officielles à l’échelle mondiale entre elles et avec la production courante des salles de spectacle (de l’opéra au music-hall), le but est d’explorer le continuum des approches musicales, ayant comme extrêmes la célébration et la parodie. De l’exposition universelle de Londres en 1851 à celle de New York en 1939-40, tout en incluant des manifestations publiques diverses, cette rencontre a pour but de faire dialoguer les genres ainsi que leur cadre institutionnel, leurs publics et leurs acteur-ice-s. La période de 1840 à 1940 permet aussi d’envisager le phénomène d’industrialisation de la vie publique et privée des grandes révolutions du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale.
Parmi la multitude d’aspects qui peuvent être abordés durant ce colloque, les suivants constituent une liste de sujets privilégiés :
- Le rôle des institutions musicales et théâtrales dans les expositions universelles et les cérémonies officielles ou solennelles célébrant la technologie ;
- Le thème de la technologie dans la programmation musicale et théâtrale entourant les expositions universelles ou y faisant référence ;
- Les influences des expositions universelles ou des cérémonies officielles célébrant la technologie sur l’esthétique musicale, le système de production ou le statut des musicien-ne-s ;
- L’orchestration, la virtuosité vocale et le tour de force compositionnel comme expression de la supériorité technologique ;
- La « déshumanisation » de la musique et l’esthétisation de la machine ;
- L’esthétique de la démesure, entre solennité et parodie.
D’autres axes de recherche possibles pourront élargir la perspective et permettre une contextualisation plus riche (liste non exhaustive) :
- La redécouverte et l’interprétation de la musique ancienne dans un rapport direct ou indirect avec l’innovation ;
- L’organologie historique entre muséification et promotion de l’industrie musicale ;
- L’urbanisme et les nouveaux modes de consommation de la culture ;
- Le réseau d’échange et de diffusion des acteur-trice-s culturel-le-s durant les expositions universelles ;
- La réception et le public des expositions universelles.
Informations pratiques
Langue des communications : français, anglais, allemand.
Langue du support visuel (diaporama ou autre) : anglais.
Durée des communications : 25 minutes.
Soumission des propositions : formulaire en ligne (résumé de 250 mots + notice biographique).
Délai de soumission : 9 juin 2025
Organisateurs du colloque
Guillaume CASTELLA, Haute école de musique de Genève (guillaume.castella@hesge.ch)
Federico LAZZARO, Université de Fribourg (federico.lazzaro@unifr.ch)
Comité scientifique
Steven HUEBNER (McGill University)
Sarah KIRBY (University of Melbourne)
Emmanuel REIBEL (École normale supérieure de Lyon)
Anna STOLL-KNECHT (Université de Fribourg)
Massimiliano SALA (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)
La bibliographie sélective est à lire dans le document annexé.