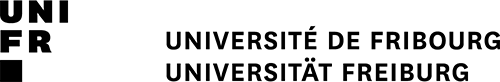Jouer, apprendre... et tricher
Le projet européen «Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity», dirigé par la Professeure Véronique Dasen et financé par le Conseil européen de la recherche (ERC), s’est plongé dans l’exploration de la culture ludique antique. Une équipe pluridisciplinaire a rassemblé de manière systématique un vaste ensemble de sources écrites, archéologiques et iconographiques relatives au jeu et au jouet en Grèce et à Rome. Un des objectifs était d’élaborer une nouvelle définition théorique du «jouer» adaptée aux spécificités du monde grec et romain. L’étude a mis en valeur les différences qui distinguent pour les Anciens le jeu libre, paidia, volontaire et spontané, associé à pais, l’enfant, du sport, athlon, où seuls les meilleurs s’entrainent, s’affrontent et reçoivent des prix officiels. Les pratiques ludiques entretiennent aussi des liens privilégiés avec d’autres activités, notamment divinatoires et rituelles.
Hier comme aujourd’hui, le jeu est un révélateur des dynamiques sociales, étroitement associé au plaisir et à l’expression des émotions. Les textes et les images ont ainsi fait apparaître sous un jour différent les relations entre enfants et intergénérationnelles, entre femmes et hommes, individus libres et esclaves, dieux et mortels. Un relief funéraire de Grèce centrale (fin Ve s. av.-C.) a révélé la plus ancienne leçon de mathématique entre un maître et son élève; elle se déroule de manière ludique sur un abaque qui sert aussi de plateau de jeu. Des objets inattendus ont également contribué à renouveler nos connaissances sur des aspects négligés de la vie sociale.
Le jeu n’est pas uniquement synonyme d’apprentissage des règles de la vie sociale et de cohésion communautaire. L’activité peut être aussi transgressive et déshonorante quand elle est associée à des paris d’argent. Dès la deuxième moitié du Ve siècle av. J.-C. des voix s’élèvent pour dénoncer le désordre causé par les excès aux jeux de dés. La passion des jeux d’argent va de pair avec la triche. Des lois sont édictées sous la République déjà pour les interdire. Différentes manières de modifier les dés pour favoriser un coup gagnant avaient été identifiées sans faire encore l’objet d’une étude systématique. Dans le cadre de sa thèse sur le jeu et la sociabilité en Gaule romaine, Thomas Daniaux a élaboré la première typologie de leurs techniques de fabrication. Aux dés en os ou ivoire aux arêtes biseautées, aux faces bombées aux chiffres dédoublés sur deux faces, s’ajoutent ceux, plus rares, fourrés de plomb sur la face opposée à la valeur recherchée, d’ordinaire le 6, la valeur maximale.
Une découverte sensationnelle est venue témoigner d’une ingéniosité encore plus raffinée. Parmi le matériel mis au jour dans le dépotoir de la villa romaine de Mageroy (Belgique) en 2020, un dé miniature, de moins d’un centimètre de côté, a révélé en se brisant une technique inconnue: il était minutieusement évidé et contenait du mercure! Une enquête réunissant différents spécialistes en physique des matériaux, mercure, géologie… et un magicien belge, Eric Magic, possédant des exemplaires modernes similaires, a été menée pour comprendre le fonctionnement de cet artefact exceptionnel. Grâce à sa densité très lourde, le mercure, un métal liquide, lestait le dé à la façon du plomb, mais de manière mobile, temporaire, permettant de favoriser n’importe quelle face. La tomographie du dé réalisée au Département de géosciences montre la technique de creusage de l’intérieur par une série d’ocelles minuscules refermées de manière invisible à l’œil nu. Le coup désiré pouvait être forcé par une manipulation du joueur qui faisait s’écouler le mercure sur la face opposée en le laissant reposer ou en le tapant. Les recherches se poursuivent pour déterminer son lieu de fabrication, probablement Rome. La virtuosité de l’artisan, tout comme le coût élevé de cet objet si sophistiqué, suggèrent l’importance des montants en jeu lors de paris.