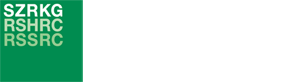Dernier Numéro
Volume 118 (2024)
THÈME: Religion et mémoire postcoloniale
-
Felicity Jensz | Films of Faith and Colonial Fantasy in Inter-War Germany
Films de foi et de fantaisie coloniale – Mémoires religieuses postcoloniales
dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerresAprès la ‹perte› des colonies à la fin de la Première Guerre mondiale, les sociétés missionnaires allemandes se sont tournées vers le cinéma pour diffuser des informations sur le travail religieux, y compris dans les anciennes colonies allemandes. Entre 1927 et 1960, plus de 65 films missionnaires ont été produits par des sociétés missionnaires catholiques et protestantes, dont beaucoup avaient un lien explicite avec les anciennes colonies allemandes. Le média du film n’a pas été étudié en termes de contribution à l’élaboration de la mémoire religieuse postcoloniale. Cet article se concentre sur les films de missionnaires protestants et leur documentation afin de démontrer qu’ils étaient imprégnés de ‹nostalgie impériale›/‹nostalgie impérialiste› (Lorcin/Rosaldo) ainsi que de ‹nostalgie coloniale› (Lorcin) et qu’ils étaient utilisés par le mouvement révisionniste colonial populaire pour revendiquer moralement le retour des colonies et le rôle des missionnaires allemands. Dans l’agitation culturelle et politique de la fin des années 1920, le lien avec l’élaboration de la mémoire politique et religieuse a été brouillé par l’utilisation de la nostalgie coloniale et impérialiste dans les films missionnaires.
Films – propagande – mission protestante – Allemagne post-coloniale – entre-deux-guerres.
-
Daniel Annen | Reziproke Missionierung - Thomas Immoos
La mission réciproque chez Thomas Immoos
Thomas Immoos était un prêtre catholique qui avait fréquenté le gymnase des Frères de Bethléem à Immensee et qui fut plus tard membre de cette société missionnaire. Né en 1918 à Schwyz et ayant grandi à Steinen, il a donc probablement vécu dans son enfance et son adolescence le système de normes oppressif du milieu catholique. Ceci est d’autant plus intéressant qu’il a connu des mentalités très différentes au Japon et dans le reste du monde. Au début des années cinquante, il a commencé à enseigner au Japon, activité qu’il a conservée jusqu’à sa mort en 2001, à partir de 1962 en tant que professeur de littérature allemande à l’université de Tokyo. Il a toutefois interrompu de temps en temps son séjour au Japon, d’une part pour passer son doctorat à l’université de Zurich en 1961 sous la direction du célèbre germaniste Emil Staiger, d’autre part tout simplement pour rendre visite à sa Suisse centrale natale, qu’il aimait toujours autant. Ses origines suisses et son sacerdoce catholique n’auraient-ils pas dû le pousser à faire du prosélytisme au Japon en faveur de sa confession d’origine? On pourrait s’y attendre, mais ce n’était pas le cas, pas pour Thomas Immoos. Même en tant que missionnaire en terre étrangère, il est resté le chercheur, le questionneur. Au lieu d’imposer une religion, il a cherché ce qui unissait la religiosité japonaise et les positions catholiques. On peut donc qualifier son prosélytisme de réciproque. Ses recherches se sont concentrées sur le théâtre de culte japonais, le shintoïsme ou encore le bouddhisme, où il a trouvé des similitudes et des analogies, ce qui lui a permis d’attirer l’attention sur les déficits du catholicisme. La théorie des archétypes de C.G. Jung lui a été utile. Ironiquement, on pourrait presque dire que le regard de Thomas Immoos sur l’Extrême-Orient peut révéler de nouvelles perspectives psychologiques et théologiques pour l’Occident proche.
Catholicisme de milieu – système de normes – analogies – théâtre de culte – shinto – bouddhisme – réciprocité.
-
Fabio Rossinelli and Filiberto Ciaglia | The Collateral Activities of Missionaries in Southern Africa between Exploration and Exploitation
Mémoires en tension – Les activités collatérales des missionnaires en Afrique australe entre exploration et exploitation au 19ème siècle
Cet article analyse les activités de plusieurs missionnaires européens qui ont travaillé au Lesotho, en Zambie, au Mozambique et au Transvaal au 19ème siècle dans le cadre des Missions de Paris (Société des Missions évangéliques de Paris, fondée en 1822) et de Lausanne (Mission romande, ancienne Mission vaudoise, 1874). L’accent est mis sur la manière dont ces missionnaires ont développé leurs intérêts personnels en dehors de leur mandat. Le savoir et l’argent étaient en jeu. Alors que certaines activités étaient rendues publiques, d’autres étaient traitées avec la plus grande discrétion. Cela a affecté et façonné la manière dont la mémoire missionnaire a été construite. Les sources utilisées pour cette étude sont répertoriées dans une base de données créée par les auteurs eux-mêmes, avec une équipe pluridisciplinaire en Italie: missioniprotestanti-africaaustrale.org (en ligne depuis 2022, interactive à partir de 2024).
Mission – Afrique australe – savoir – argent – mémoire – souvenir.
-
Christian Antonio Rosso I Le memorie dei padri della Consolata e dei frati minori in Somalia
«Au pays des arômes» – Histoire de l’expérience missionnaire catholique en Somalie au 20ème siècle dans les mémoires des Pères de la Consolata et des Frères Mineurs
Il existe un lien profond entre l’histoire de la mission catholique en Somalie et les événements politiques de la dernière colonie italienne, en étroite dépendance des saisons que le colonialisme a connues dans la succession des époques libérales et fascistes, des adminis-trations britanniques et italiennes. Cet article tente de rendre compte succinctement des différentes phases de l’expansion missionnaire en Somalie, à partir de la tentative pionnière des Trinitaires, qui débuta en 1904, jusqu’à celle plus durable des Frères Mineurs, après la brève et significative parenthèse des Pères de la Consolata, par le biais des mémoires des missionnaires. Les mémoires conservés dans les archives ou remis à la presse montrent clairement la conscience avec laquelle les missionnaires «faisaient» la mission, les motivations qui sous-tendaient leurs actions, la confusion entre civilisation et christianisation. Ils attestent également la présence de plusieurs centres de production «idéologiques»: l’un central au Vatican et un autre plus périphérique enclin à la compromission avec le fascisme. Le retour de l’Italie dans la Corne de l’Afrique en 1950 en tant que puissance fiduciaire a représenté pour les religieux l’occasion d’une réécriture de l’histoire de leur présence en Somalie, non sans ambiguïtés, omissions et réticences.
Somalie – Pères de la Consolata – civilisation – christianisation – expansion missionnaire – souvenirs.
-
Mick Feyaerts, Simon Nsielanga and Idesbald Goddeeris | Congolese Religious Memories of the Colonial and Missionary Past
Le pouvoir du silence – Souvenirs des religieux congolais du passé colonial et missionnaire
Cet article examine comment les religieux congolais – les Jésuites et les Annonciades au Congo ainsi que le clergé congolais en Belgique – se souviennent du passé colonial et du rôle des missionnaires. Il montre qu’ils l’abordent le plus souvent en termes positifs, voire avec gratitude et louange, bien qu’il y ait aussi de vagues critiques et, dans les années 1970, dans le contexte de l’africanisation, une opposition explicite contre le récit dominant. La mise sous silence des pages sombres du passé colonial peut s’expliquer de plusieurs manières. Ce faisant, les religieux congolais surmontent une lecture de l’histoire coloniale du Congo dans laquelle les Congolais ne sont que des victimes, et reprennent le contrôle de leur propre histoire. Ils confirment également leur appartenance à leurs congrégations transnationales et à l’Église catholique en général. Enfin, la dominance d’éléments positifs dans ces mémoires collectives coloniales doit également être lue dans le contexte du délabrement des infrastructures et de l’impuissance politique du Congo d’aujourd’hui. Le contraste avec l’époque coloniale permet aux religieux congolais d’exprimer implicitement une mise en accusation des autorités tout en les préservant d’actions répressives.
Missionnaires – mémoire – décolonisation – Congo – Belgique.
-
Silvia Cristofori | The Ibadan School and Historiographical Continuity as a Decolonisation of Africa's Past
L’histoire comme réalité vivante – L’école d’Ibadan et la continuité historiographique comme décolonisation du passé africain
Cet article analyse quelques travaux de l’école historiographique d’Ibadan dans le but de montrer comment, dans un contexte de nationalismes africains, elle entendait donner une légitimité historiographique à la conscience historique africaine. D’une part, elle révèle à quel point l’historiographie, jusqu’alors, n’avait pas seulement écrit une histoire partielle, mais était aussi un dispositif idéologique de domination. D’autre part, elle a tenté d’établir une continuité historiographique avec les traditions orales africaines et les histoires non académiques écrites par l’élite chrétienne nigériane depuis les années 1870. Cet article met en lumière l’un des héritages les plus intéressants de l’école d’Ibadan, à savoir la question non résolue selon laquelle, si l’écriture de l’histoire, qu’elle soit académique ou non, a permis de relier le passé africain à une histoire universelle et de le mettre en relation avec d’autres expériences humaines, elle a également déconnecté la tradition orale du sens de l’histoire qu’elle avait exprimé dans son propre contexte de production.
Historiographie africaniste – école historiographique d’Ibadan – décolonisation de l’histoi-re – nationalisme et historiographie – l’historiographie de l’élite chrétienne africaine au 19e siècle – traditions orales africaines et historiographie.
-
Francesca Badini | The Use of ‹Collective Memory› in Muhammad al-Gazali's Religious Discourse
L’utilisation de la ‹mémoire collective› dans le discours religieux de Muḥammad al-Ġazālī – la bataille de Badr (624) et la guerre d’Octobre (1973)
Le but de cet article est d’explorer la possibilité d’analyser le concept d’utopie rétrospective dans la prédication de Muḥammad al-Ġazālī (1917–1996) comme une reconstruction de la ‹mémoire collective›. L’analyse porte sur le sermon qu’al-Ġazālī a présenté à la mosquée ʿAmr ibn al-ʿĀṣ du Caire le 14 décembre 1973, à propos du verset Q. 2:217. L’analyse du sermon en question présente la stratégie exégétique avec laquelle al-Ġazālī a réussi à justifier les événements liés à la guerre d’Octobre 1973, c’est-à-dire l’attaque par les forces égyptiennes pendant ce qui était considéré comme le mois sacré, à la bataille de Badr en 624, un événement retravaillé par la tradition islamique et présenté à la communauté islamique sous l’angle de la ‹mémoire collective›. Dans cette contribution, je présente les deux événements historiques considérés, je contextualise l’activité de prédication d’al-Ġazālī en 1973, en faisant allusion à la relation entre l’exégète et la représentation politique de l’État égyptien dans ces années-là, puis j’analyse le sermon considéré, en expliquant pourquoi l’auteur a choisi de justifier les actions du président Anouar el-Sadate (1918–1981) par le prosélytisme religieux et par le rappel de la ‹mémoire collective›.
Muḥammad al-Ġazālī – guerre d’octobre 1973 – bataille de Badr – communauté islamique – tradition islamique – État égyptien – Anouar el-Sadate.
-
Marcello Grifò | Memoria e missione nella riflessione teologica post-coloniale
Au-delà du mal, les martyres de la mémoire – Pour une histoire des catégories de la mémoire et de la mission dans la réflexion théologique postcoloniale
Après avoir examiné l’approche de la mémoire en Afrique pendant la période coloniale – tantôt évocatrice, tantôt substitutive – cette contribution, qui tente de retisser les minces fils de la toile complexe d’une histoire tourmentée, se propose d’enquêter sur sa fonction, en particulier au crépuscule de ce temps controversé, lorsque la mission a cessé d’être l’un des principaux canaux de propagation des valeurs et des modes de vie européens et que, à l’inverse, un sérieux processus d’inculturation de la foi a commencé d’un point de vue théologique, liturgique et anthropologique, ainsi que la construction d’une société équitable et moderne à laquelle les Églises ne voulaient pas manquer d’apporter leur contribution spécifique. Par conséquent, la catégorie de mission ne coïncide plus avec l’effort d’extension de la foi chrétienne mais, en véhiculant une annonce de l’Évangile qui n’est plus séparable d’un lien génétique avec la justice sociale, la redistribution équitable des ressources, la démocratie et la réconciliation universelle, elle prend un caractère résolument civil. C’est dans cette perspective que, parmi les nombreuses conjugaisons possibles de la fabrication de la mémoire, la présente étude a choisi de mettre en lumière une déclinaison théologique inédite de celle-ci, dont l’investigation reste l’une des moins poussées en histoire et en anthropologie. Elle dépasse les spécificités de la mémoire endogène et l’élève au rang de signe d’une universalité de la raison qui implique le partage de principes fondamentaux et fondateurs et la poursuite d’un but commun à l’humanité de toutes les confessions et de toutes les ethnies.
Martyria – mémoire – mission – théologie post-coloniale – inculturation – vie européenne – justice sociale – universalité.
-
Ilaria Macconi | Inculturazione e ‹decolonizzazione› della missione in Africa
Inculturation et ‹décolonisation› de la mission en Afrique – Pour un nouveau récit sur l’évangélisation
Dans ma contribution, j’ai l’intention d’analyser comment, dans la période qui a suivi immédiatement les processus de décolonisation en Afrique et sous l’impulsion du Concile Vatican II, un autre récit sur l’évangélisation s’est imposé et, avec lui, la nécessité de rechercher de nouveaux modèles de référence pour la rencontre avec l’autre. En ces années de profondes transformations, l’Église s’interroge non seulement sur l’avenir de la mission, mais aussi sur son passé. Au centre de cette «révision» de la mémoire missionnaire se trouve le débat sur la relation complexe entre foi et culture, qui conduira également à la décolonisation de l’idée même de mission. En effet, la prise de conscience qu’on ne peut évangéliser sans une véritable «inculturation» du message du Christ émerge avec prépondérance. Les actes des conférences et des semaines d’étude nous permettent de suivre les principaux points de jonction de la discussion, tandis que les écrits des missionnaires (en particulier du Kenya) témoignent de la transposition dans la vie de tous les jours.
Afrique – culture – décolonisation – évangélisation – foi – inculturation – mémoire – mission – missionnaires – récit.
-
Madelief Feenstra | Postcolonial Memory at Work in Two Dutch Protestant Churches
«Il est temps de montrer la voie» – La mémoire postcoloniale à l’œuvre dans deux églises protestantes néerlandaises
À l’instar d’autres anciennes métropoles coloniales, les Pays-Bas ont connu ces dernières décennies l’émergence d’importants débats sociétaux et académiques sur la nature et l’héritage du passé colonial du pays, et plus particulièrement de l’esclavage. Ces dernières années, de plus en plus d’institutions traditionnelles – des musées aux administrations municipales – ont lancé des programmes visant à examiner et à reconnaître «leur» implication historique dans la traite transatlantique des esclaves ou, d’une autre manière, à procéder à des examens critiques de la façon dont les traces de ce passé imprègnent le présent. Cet article explore la manière dont deux communautés ecclésiastiques néerlandaises, à savoir l’Église évangélique luthérienne d’Amsterdam et la Fraternité évangélique de la ville d’Amsterdam et du Flevoland, participent activement à ce changement et s’engagent dans l’histoire et l’héritage du passé esclavagiste. Elle le fait à travers l’analyse d’une publication initiée par les deux congrégations et publiée en 2020, qui détaille le programme d’un groupe de travail que ces deux communautés ont conjointement mis en place et qui inclut des textes issus d’un concours d’essais, d’un symposium et de sermons.
Mémoire postcoloniale – Pays-Bas – esclavage – religion – mission – Suriname – Église évangélique luthérienne – Église morave.
DOSSIER: PROMOUVOIR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE DANS LE CADRE DU PROCESSUS D’HELSINKI
-
Eva Maurer | Das Schweizerische Ost-Institut, die Kirchen und die Menschenrechte
Qu’en est-il de la religion? – L’Institut suisse d’études est-européennes, les Églises et les droits de l’homme 1974–1975
En 1974–1975, durant la phase finale des négociations de l’OSCE, l’Institut suisse d’études est-européennes (Schweizerisches Ost-Institut, SOI), à Berne, a publié plusieurs textes sur la relation entre religion et communisme. Tout en adoptant une position critique à l’égard du processus de négociation, cet institut de recherche anticommuniste a utilisé la rhétorique des droits de l’homme popularisée dans les années 1970 pour dénoncer l’oppression dans les pays situés derrière le rideau de fer. Cette orientation n’était toutefois pas uniquement motivée par la situation critique des pratiquants religieux en Europe de l’Est, mais liée à une critique des tendances ‹gauchistes› au sein des organisations ecclésiastiques suisses. Publiées peu avant les élections cantonales et nationales, ces publications ont été secrètement cofinancées par des représentants Zurichois du parti libéral suisse (FDP). Leur style polémique a toutefois été rejeté, même au centre de l’échiquier politique. Après le milieu des années 1970, l’intérêt de l’Institut pour les questions religieuses semble s’être estompé et, contrairement à l’Institut Glaube in der Zweiten Welt (G2W), l’Institut ne s’est guère intéressé pour les nouveaux groupes de défense des droits de l’homme dans les pays socialistes.
Processus de l’OSCE – Schweizerisches Ost-Institut – Peter Sager – anticommunisme – religion – Église – droits de l’homme – Europe de l’Est – Suisse.
-
Erik Sidenvall | Missionary Enthusiasm and Human Rights Activism
Enthousiasme missionnaire et activisme en matière de droits de l’homme – Une étude du monde politico-religieux de la Mission Slave suédoise, 1965–1985
Cet article analyse la manière dont la Mission slave suédoise (Slaviska missionen) s’est impliquée dans l’activisme en faveur des droits de l’homme entre le milieu des années 1960 et 1989. Il affirme que la défense des droits de l’homme, principalement axée sur la situation des protestants en Union soviétique, a entraîné une redéfinition de l’image publique de la mission. En tant que précurseur, elle est devenue partenaire d’un réseau peu structuré d’ONG de défense des droits de l'homme.
Droits de l’homme – Guerre froide – Protestantisme – Mission chrétienne – religion – Union soviétique – Mission Slave.
-
Markku Ruotsila | Finnish Churches and the Helsinki Process in Transnational Perspective
Détente, finlandisation et résistance – Les Églises finlandaises et le processus d’Helsinki dans une perspective transnationale
Cet article reconstitue l’ensemble des opinions des Églises finlandaises concernant le processus d’Helsinki à partir d’une série de correspondances privées contemporaines et d’archives institutionnelles, de la presse religieuse et de sources d’histoire orale. Il montre que, parallèlement au discours officiel de célébration axé sur la détente et l’instauration de la confiance, le processus d’Helsinki a donné lieu à une contestation vigoureuse et prolongée dans toute la société civile finlandaise, y compris dans les Églises. Ce fut notamment le cas en ce qui concerne la nature des droits de l’homme à protéger dans le cadre du Panier III de l’Acte final d’Helsinki. Sur cette question, les dirigeants œcuméniques de l’Église finlandaise se sont fondamentalement opposés aux néo-piétistes évangéliques qui constituaient la majeure partie des fidèles actifs de leur Église. Comme une grande partie du reste du mouvement œcuménique, les premiers ont opté pour un programme socialement progressiste pour la CSCE/OSCE qui aspirait à une convergence des deux systèmes économiques concurrents et mettait de côté la liberté religieuse au profit des ‹droits sociaux de l’homme›. Ces derniers, en revanche, ont rejeté la détente ainsi que l’instauration d’un climat de confiance et ne se sont intéressés au processus d’Helsinki que comme moyen de faire progresser leurs propres objectifs de liberté religieuse dans les pays contrôlés par l’Union soviétique.
Œcuménisme – évangélisme – fondamentalisme – droits de l’homme – finlandisation – retour en arrière – contrebande de la Bible – OSCE – CSCE.
-
Roland Cerny-Werner | Der Vatikan im internationalen Raum
Le Vatican dans l’espace international – Un tournant épistémologique entre la Seconde Guerre mondiale et Vatican II
Le pape s’est toujours senti compétent pour le monde entier, mais jusqu’au 20ème siècle, il le faisait avec un regard plutôt exclusiviste et supra-sociologique sur le «monde entourant l’Église». Mais avec les défis dramatiques du 20ème siècle, une transformation théologique, politique et épistémique, au sens foucaldien du terme, s’est amorcée. Un processus que l’on peut bien comprendre à l’aide de la diplomatie papale dans le sillage de la guerre froide qui se formait et se fondait ainsi que de la menace d’anéantissement existentiel de la terre entière qui y était intégrée. Cette nouvelle orientation a connu son apogée avec le «discours de paix» de Paul VI devant l’ONU, mais elle avait déjà commencé sous les pontificats de ses prédécesseurs directs après les deux guerres mondiales. C’est ainsi que le Saint-Siège a commencé à conceptualiser son engagement dans l’espace international et, surtout, à lui donner un fondement théologique. Avec le tournant ecclésiologique de Vatican II et le rejet de l’Église en tant que «societas perfecta» qui l’accompagnait, le pape a gagné un prestige évident dans la sphère internationale en tant qu’agent authentique de la «sauvegarde de la création».
Politique internationale de l’Église – Guerre froide – Ostpolitik vaticane – histoire de la diplomatie – Concile Vatican II – diplomatie de la paix – histoire de la théologie.
-
Katharina Kunter | Historical Perspectives on Churches and the New Geopolitical Challenges in Europe
Adieu à l’idée de neutralité – Perspectives historiques sur les églises et les nouveaux défis géopolitiques en Europe
Au cours des deux premières années de la guerre d’agression russe en Ukraine, de nombreux représentants des églises œcuméniques ont invoqué les instruments de la politique de détente des années 1970 pour légitimer leurs positions politiques actuelles sur la guerre en Ukraine. Les termes ‹dialogue› et ‹neutralité› ont joué un rôle central à cet égard. L’article examine dans quelle mesure des institutions chrétiennes influentes au niveau mondial, telles que le Vatican, le Conseil œcuménique des églises et d’autres organisations religieuses, se sont considérées comme des acteurs neutres pendant la guerre froide et ont cultivé une perception d’elles-mêmes cohérente avec cette position. La ‹neutralité› est introduite et utilisée comme catégorie historique en analysant le rôle des églises en tant qu’acteurs supposés neutres et les limites de leur engagement politiquement ‹neutre›. L’accent est mis sur les églises protestantes.
Guerre froide – Détente – Dialogue – Neutralité – Conseil œcuménique des Eglises – Guerre d'Ukraine – 20e siècle – années 1970.
-
Massimo Faggioli | The Holy See's Appeals to Helsinki 1975 for Peace in Ukraine
«Nous avons besoin d’un nouvel esprit d’Helsinki» – Les appels du Saint-Siège à Helsinki 1975 pour la paix en Ukraine dans une perspective historique
L’article analyse les invocations de ‹l’esprit d’Helsinki› (les accords d’Helsinki de 1975, dans lesquels le Saint-Siège s’est pleinement impliqué) lors des efforts du pape François et de la diplomatie vaticane pour mettre fin à la guerre en Ukraine suite à l’invasion lancée par la Russie le 24 février 2022. Ces invocations ont été répétées pendant la première année de la guerre en Ukraine et ont montré la distance entre les aspirations du Saint-Siège et celles de la Russie et de l’Ukraine, mais aussi la différence entre la diplomatie vaticane et ‹l’Ostpolitik› dans le contexte de la Guerre froide et dans le bouleversement de l’ordre international au 21èmesiècle.
Accords d’Helsinki – diplomatie vaticane – Guerre froide – papauté – Ostpolitik – Guerre russo-ukrainienne.
VARIA
-
Stefan Bojowald | Eine kleine Beobachtung zur Lasterhaftigkeit der Mönche in der koptischen Vita Pachomii
Une brève observation sur la dépravation des moines dans la Vita Pachomii copte
Cet article tente une nouvelle approche d’un passage de la Vita Pachomii copte. L’accent est mis sur la description de la vie débridée de certains moines. Le désir de porter de beaux vêtements et d’autres plaisirs mondains est spécifiquement critiqué. Le même motif peut être isolé dans l’Apocalypse syrienne du Pseudo-Méthode.
Patristique copte – patristique syrienne – vêtements – Vita Pachomii – Apocalypse du Pseudo-Méthode.
-
Paul Bühler-Hofstetter | Die Madonna in den Erdbeeren – Symbolik und Hintergründe
La Madone aux fraises – symbolique et contexte
Le tableau «La Madone aux fraises» se caractérise par un riche symbolisme: Des fraises comme nourriture pour les enfants décédés, une enfant avec une cruche de larmes pour un enfant décédé. Il s’agissait probablement d’une image commémorative pour un enfant décédé. Une légende concernant la petite cruche de larmes veut dire que nous pouvons confier les enfants décédés à Marie, qui veut leur procurer un accès au paradis. On suppose que le peintre est Hans von Tieffenthal de Schlettstadt. Le tableau a été acheté en 1865 par l’association artistique de Soleure dans l’ancien couvent Saint-Joseph de la ville. Selon une légende fluviale, le tableau aurait descendu l’Aar à l’époque de la Réforme (1528) et aurait été confié à des sœurs pieuses. Le fait qu’il se trouvait à l’abbaye de Gottstatt peut être déduit du patronage marial et de la proximité géographique avec Soleure. Le comte Conrad III de Neuchâtel, fils adoptif de la veuve du dernier comte de Nidau de la dynastie fondatrice de Gottstatt, peut être considéré comme le donateur.
Histoire de l’art – Symbolique – Image commémorative – Soleure – Epoque de la Réforme – Abbaye de Gottstatt.
-
Nicolas Giel | Deutsche Ideen in römischen Händen? – Eine komparative Analyse der De concordantia catholica von Nicolaus Cusanus und der Declamatio von Lorenzo Valla
Des idées allemandes dans les mains des Romains? – Une analyse comparative du De concordantia catholica de Nicolaus Cusanus et de la Declamatio de Lorenzo Valla
A sept ans d’intervalle, Nicolaus Cusanus puis Lorenzo Valla se sont demandés si la donation de Constantin est fidèle à la vérité. Cette proximité temporelle a soulevé la question si Valla était influencé par Cusanus dans sa réfutation de la donation. L’article suivant se penche sur cette question afin d’y apporter une réponse. Pour ce faire, il compare les arguments de réfutation de la donation de Constantin ainsi que les programmes de domination présentés par Cusanus et Valla dans leurs deux ouvrages respectifs, le De concordantia catholica et le Declamatio. La comparaison montre clairement qu’il existe suffisamment d’arguments pour supposer que Valla a été inspiré par Cusanus. Les deux textes divergent cependant sur plusieurs points essentiels, c’est pourquoi il serait exagéré de parler d’influence. Il apparaît clairement que Cusanus favorise l’empereur dans son idéologie politique et accorde un rôle particulier aux conciles. Valla, en revanche, favorise la ville de Rome et les souverains en général. Le pape doit conserver sa position de primauté au sein de l’Église.
Nicolaus Cusanus – De Concordantia catholica – Lorenzo Valla – Declamatio – idéologie politique – donation de Constantin.
-
Mariano Delgado | Pioniere der Missionsutopie und der Missionsethnographie der Frühen Neuzeit – 1524 kamen die ersten zwölf Franziskaner nach Mexiko
Pionniers de l’utopie missionnaire et de l’ethnographie missionnaire du début des temps modernes – en 1524, les douze premiers franciscains arrivèrent au Mexique
L’article se penche sur les ombres et les lumières de la Mission franciscaine du 16ème siècle au Mexique. Ils étaient pionniers de l’utopie missionnaire avec une tendance à la «francisation» des Indiens et pionniers de l’ethnographie missionnaire avec une double intention: mieux éradiquer l’idolâtrie et sauver l’honneur des cultures indiennes. En raison notamment de l’imbrication de la conquête coloniale et de l’évangélisation, les franciscains n’ont pas toujours été en mesure de suivre «les traces» de leur père Saint François. Néanmoins, leur mission au Mexique fait partie, dans l’ensemble, des chapitres les plus brillants de l’histoire de l’Église.
Mission au Mexique – Mission franciscaine – utopie missionnaire – ethnographie missionnaire.
-
Heins Sproll | Christianisierung oder Sinisierung in der frühen Chinamission? Die Inkulturationsmethode Matteo Riccis SJ am Beispiel seiner auf Cicero referenzierenden Schrift De amicitia
Christianisation ou sinisation dans les débuts de la mission en Chine? La méthode d’inculturation de Matteo Ricci SJ à l’exemple de son écrit De amicitia, qui se réfère à Cicéron
L’article examine, dans une perspective historique globale, la méthode d’inculturation intrinsèquement inclusive de Matteo Ricci (1552–1610) comme une voie de christianisation qui prenait au sérieux la culture de l’empire chinois de la fin de la dynastie Ming dans son altérité par rapport à l’Europe. Grâce à l’interprétation humaniste du De amicitia de Cicéron, Matteo Ricci parvint à pénétrer l’espace de communication des mandarins lettrés de manière à «traduire» le contenu éthique de cet écrit en valeurs confucéennes compatibles avec lui. Il s’agit de savoir comment Ricci, grâce à sa capacité d’apprentissage linguistique et interculturel, a su transformer la capacité de connexion communicative de la prétention chrétienne à la vérité et à l’universalité du salut en opérations de transmission qui ont eu des effets christianisants, au sens humaniste contemporain, chez certains de ses destinataires de l’élite méritocratique de la cour impériale. La question de départ concernant le résultat de ces opérations est donc réglée: christianisation de la Chine ou sinisation de la mission chrétienne.
Marcus Tullius Cicero (106–43) – Matteo Ricci (1552–1610) – Cour impériale chinoise des Ming – fonctionnaires lettrés confucéens (litterati) – méthode d’inculturation – sinisation – querelle des rites.
-
Zélian Waeckerlé | Une paroisse «franco-suisse» en diocèse de Bâle au XVIIIe siècle – regards transfrontaliers sur Rodersdorf et ses annexes de Liebenswiller et Biederthal (selon les sources locales)
Une paroisse «franco-suisse» en diocèse de Bâle au XVIIIe siècle – regards transfrontaliers sur Rodersdorf et ses annexes de Liebenswiller et Biederthal (selon les sources locales)
Une frontière, au sens étatique moderne et contemporain du terme, a-t-elle un pouvoir de contrôle sur la vie religieuse des territoires et populations qu’elle délimite? Les paroisses des confins jurassiens de l’Alsace des Bourbons apportent quelques éléments de réponse qui tendent vers la porosité, du moins la relativité de la frontière étatique. D’autant plus que les délimitations spirituelles ne se superposent pas aux bornes temporelles. Ainsi le chapitre rural du Leimental comprend-il aussi bien des paroisses relevant du royaume de France que des États helvétiques. À cause de ses deux annexes françaises, la paroisse de Rodersdorf a été qualifiée de «paroisse internationale» par l’historiographie locale. Si cet adjectif est vrai en théorie, la quasi-inexistence de ruptures socio-culturelles entre Rodersdorf et ses annexes laisse penser que cette paroisse est à l’inverse intégrée à un territoire – un pays de connaissance – plus flou. Paroisse «franco-suisse» ou frontière fictive?
Royaume de France – États helvétiques – «paroisse internationale» – Paroisse «franco-suisse» frontière – Jura – Alsace.
-
Johan Smits | Towards a Contextual Canon of Theology – A Network-based Approach to German Academic Theology (1820–1870)
Vers un canon contextuel de la théologie – Une analyse de réseaux de la théologie académique allemande (1820–1870)
Dans le domaine de la théologie historique, la réception ultérieure est souvent le principal critère pour établir l’importance d’un ouvrage. Cet essai démontre que les différents outils de l’analyse des réseaux sociaux permettent d’obtenir une vue d’ensemble du paysage théologique qui peut inclure les différents facteurs et développements contextuels. Après une présentation de la méthodologie appliquée, l’essai explore la pertinence des institutions de l’administration ecclésiastique et des associations pour le paysage théologique au milieu du dix-neuvième siècle. Il soutient que, dans le contexte d’une administration ecclésiastique toujours basée sur l’État, les associations ont forgé une sorte de scène nationale pour les théologiens universitaires. L’article se termine par une tentative d’établir un canon théologique basé sur le réseau pour les périodes 1820–1842 et 1843–1870. Enfin, les implications de ce canon au niveau individuel et institutionnel font l’objet d’une discussion critique.
Analyse des réseaux sociaux – visualisation – théologie académique – administration des Églises – sociétés – canon de la théologie – histoire de la théologie.
-
Simon Friedli | Wie Der letzte Ketzer die Vergangenheit in die Gegenwart bringt
Comment Der letzte Ketzer fait entrer le passé dans le présent
Cet article analyse le film documentaire Der letzte Ketzer, sorti en 2022, sur le paysan de l’Entlebuch Jakob Schmidlin (1699–1747), qui fut accusé d’hérésie, condamné et exécuté à Lucerne. En se basant sur les approches de l’analyse historique du cinéma de Robert Rosenstone, nous examinerons comment Der letzte Ketzer transforme son thème historique en un récit, comment celui-ci est construit, sous quelle forme et avec quelles techniques stylistiques et audiovisuelles il est mis en œuvre et quels messages le film doit finalement transmettre au public.
Documentaire – hérésie – Schmidlin – Lucerne – Ancienne Confédération – analyse filmique – histoire populaire.
-
Ulrich van der Heyden | Das Prachtboot: Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten – oder nicht
Le somptueux bateau: Comment les Allemands ont volé – ou non – les trésors artistiques des mers du Sud
Au cours des débats qui ont lieu depuis environ deux décennies en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, sur la restitution de biens prétendument volés ou spoliés dans les pays du Sud, notamment dans les anciens territoires coloniaux, des activistes dotés de connaissances historiques, mais aussi des journalistes et même des scientifiques, dont les domaines de recherche sont en fait tout à fait différents, tentent d’y prendre part. L’historien et journaliste Götz Aly, très respecté pour ses travaux de recherche sur le nazisme, en fait partie. Il a écrit un livre sur le prétendu vol d’un bateau des mers du Sud à l’époque du colonialisme allemand, qui a suscité une grande attention de la part des médias – mais aussi la contradiction et la critique des experts spécialisés.
Colonialisme allemand – restitution – mers du Sud – Wokeness – histoire coloniale.