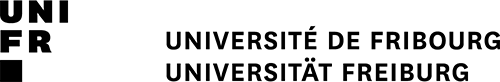Publié le 17.11.2022
Le mot du Doyen, Joachim Negel - SA 2022/II
Chers membres de la Faculté de théologie
Chères amies et chers amis
Dans le flot d’informations sur la guerre en Ukraine qui se déverse depuis des mois, une toute autre nouvelle est passée presque inaperçue. Il ne s’agit en fait que d’une annonce statistique, mais elle est d’une grande importance symbolique : au milieu de ce mois, la population mondiale a dépassé les huit milliards de personnes. Ce que cela signifie est évident : le chiffre de huit milliards signifie un doublement de la population mondiale depuis 1974 et un quadruplement depuis 1927. Selon les prévisions, ce chiffre augmentera encore de deux bons milliards dans les 30 prochaines années pour atteindre environ 10,3 milliards. Les conséquences écologiques, mais aussi économiques et sociales sont graves : changement climatique, pollution des océans, désertification de vastes zones qui ne peuvent plus être cultivées, manque d’eau potable pour des centaines de millions de personnes, urbanisation massive de la vie (aujourd’hui déjà, environ 60% de la population mondiale vit dans des villes ; le rapport social des Nations Unies prévoit pour 2035 environ 40 mégapoles dans le monde, dans lesquelles vivront jusqu’à 35 millions d’habitants, soit 1,4 milliard de personnes rien que dans les mégapoles). L’avenir s’annonce sombre – il faut le dire sobrement. Qu’avons-nous à apporter en tant que théologiens à ces changements majeurs ?
D’une certaine manière, tout d’abord peu de choses. Pas plus que la philosophie, les arts plastiques, la musique, le théâtre et bien d’autres disciplines encore. Il est toujours un peu gênant que les sciences comme la théologie, qui ont une vision « globale » de l’être humain se perdent dans le détail. Un théologien n’est pas un meilleur économiste, tout comme un musicien, un danseur, un peintre ou un sculpteur n’est pas un meilleur chimiste ou un meilleur médecin. Et pourtant, ce sont justement les sciences naturelles et économiques, dont la force est de porter le regard sur le problème individuel, qui courent le risque de ne plus trop savoir pourquoi on fait ce que l’on fait.
Et c’est ainsi que l’on arrive à ce qui arrive : tout le monde veut bien vivre, il faut donc une croissance de notre économie – disent les économistes. Pour obtenir une bonne croissance économique, il faut des innovations techniques. Pour faire progresser les innovations techniques, il faut une coopération internationale. Pour obtenir une coopération internationale, il faut accélérer les processus de communication et raccourcir les voies commerciales mondiales, etc., etc. On voit comment ce type de perception du monde nous met dans un mode agressif permanent. « Nous avons besoin de plus de croissance ! », « Le moteur de la croissance doit se remettre en marche ! », « Nous voulons sortir de la crise » – on entend de telles phrases non seulement chez les politiciens économiques libéraux, mais entre-temps aussi chez les VERTS. Ce que l’on oublie, c’est le simple fait que le marché lui-même ne produit pas de morale et de valeurs qui pourraient servir de base à des relations humaines entre tous. Ce n’est pas seulement le burn-out personnel qui menace, mais aussi le burn-out collectif à long terme – on pouvait déjà lire les chiffres correspondants dans le rapport du « Club de Rome » en 1972 et dans le rapport « Global 2000 » du gouvernement américain de l’époque en 1980. Depuis, il ne s’est presque rien passé, et si c’est le cas, c’est souvent dans la mauvaise direction.
Peut-être qu’une réflexion sur les nombreuses traditions sociales qui, dans l’histoire de l’humanité, ont toujours eu aussi une connotation religieuse, pourrait élargir l’horizon – et ce en association avec les disciplines mentionnées, à savoir l’art et la musique, la sculpture, le théâtre et la littérature, etc. Le regard économique scientiste sur le monde, exclusivement orienté vers le « progrès », a finalement un effet aussi borné qu’une religion totalitaire. Le capitalisme n’est-il pas depuis longtemps notre religion ? Ne sommes-nous pas, nous qui nous considérons comme éclairés, au-dessus de ces enfantillages ? Ce n’est pas par hasard que Jürgen Habermas parlait déjà au début des années 1990 de la « modernité qui déraille ». Le grand projet des « Lumières » était peut-être alors trop court ?
Le sociologue Hartmut Rosa de l’Université d’Iéna (il a d’ailleurs été invité aux Journées d’études théologiques de Fribourg il y a trois ans) a récemment tenu une conférence impressionnante à ce sujet lors de la réception diocésaine de Wurzbourg, avec un titre provocateur : « La démocratie a besoin de la religion ». Le petit livre bat actuellement tous les records de vente. Rosa y résume de manière concise les résultats de ses trois grandes publications de ces dernières années : (i) les problèmes massifs d’une société d’accélération, (ii) le phénomène de « résonance » comme base de relations sociales réussies et (iii) sa phénoménologie de l’indisponible. – Ces trois livres, des études sociologiques de bout en bout, sont étonnamment proches de la théologie et de l’esthétique. Et ils donnent du courage : « De nombreux représentants de l’Église », dit Rosa, « ont perdu la foi dans le fait qu’ils ont quelque chose à dire. Et pourtant, la société perd quelque chose de très important lorsque les attitudes religieuses se perdent ». En fait, il est honteux qu’un théologien doive s’entendre dire une telle évidence par un collègue sociologue. Nous recommandons vous donc vivement la lecture des écrits de Hartmut Rosa[1].
[1] Hartmut Rosa, Accélération : une critique sociale du temps, traduit de l’allemand par Sasha Zilberfarb et Sarah Raquillet, Paris: La Découverte 2010 ; idem, Résonance : une sociologie de la relation au monde, traduit de l’allemand par Sasha Zilberfarb et Sarah Raquillet, Paris: La Découverte 2021 ; idem, Rendre le monde indisponible, Paris: La Découverte 2020. – Idem, Demokratie braucht Religion (préfacé par Gregor Gysi), Munich 2022.