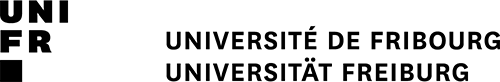Publié le 15.02.2024
Le mot du Doyen, Joachim Negel - SP 2024/I
Chers membres de la Faculté de théologie,
Chères amies et chers amis,
Chaque année, la Faculté de théologie met au concours le « Prix de la maturité ». Les bachelières et bacheliers des écoles secondaires et des lycées suisses qui ont rédigé leur travail de maturité dans le domaine « éthique, société, religion » sont invités à concourir pour ce prix. Et c’est toujours un bouquet de couleurs qui se présente : des essais, des rédactions et des présentations dans les domaines de la spiritualité, de l’histoire de la piété, des religions et de l’Église, du dialogue interreligieux, de l’art, de l’éthique, de la psychologie, de la migration, etc. Les travaux présentés sont tous d’une grande qualité ; c’est un plaisir de les lire. Une chose est cependant frappante : les travaux consacrés à un thème résolument théologique sont de plus en plus rares. Le regard sociologique extérieur prédomine : Comment les musulmans célèbrent-ils le ramadan ? Comment les demandeurs d’asile afghans s’adaptent-ils en Suisse ? Quels sont les effets psychologiques des exercices de méditation et de yoga pratiqués régulièrement ? Comment le sapin de Noël a-t-il été introduit dans les foyers suisses au xixe siècle ? Pourquoi les gens se mettent-ils en route pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ? Tous ces sujets sont intéressants, c’est certain, mais la théologie, ce serait encore autre chose. La théologie (le terme l’indique déjà) pose la question de Dieu. Et la théologie chrétienne plus spécialement pose la question de l’auto-révélation de Dieu en Jésus de Nazareth et de ce que cela signifie pour un chrétien et sa manière d’organiser sa vie : politiquement, religieusement, existentiellement. De telles questions élémentaires ne sont guère évoquées dans les travaux de maturité présentés. Que s’est-il passé ?
D’une part, cela est certainement lié à la position de la matière « religion » dans les écoles publiques. Dans la plupart des cantons suisses, celle-ci est de moins en moins dispensée sous la forme d’un cours de religion confessionnel, mais sous celle d’un cours de culture religieuse : on ne vise plus un « teaching in religion », mais un « teaching about religion », c’est-à-dire un enseignement qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une confession de foi ecclésiale, mais qui donne des informations sur les différents systèmes de religions et de visions du monde dans une perspective extérieure neutre, sans s’identifier à telle ou telle confession[1]. Cette transformation de l’enseignement religieux à l’école n’est que l’expression logique de l’évolution du paysage religieux de la Suisse dans son ensemble. Alors que dans les années 1930 déjà, la pratique religieuse dans les cantons réformés s’était considérablement affaiblie, les sociologues des religions constatent depuis les années 1970 des tendances similaires dans les régions catholiques de Suisse. Ces tendances s’accentuent rapidement à l’heure actuelle. « En 1990 encore, explique la Neue Zürcher Zeitung dans un article paru il y a quelques jours, les personnes sans confession représentaient un petit groupe de 7,5 pour cent, alors que la majorité des Suisses étaient tout naturellement réformés ou catholiques. Aujourd’hui, seule une personne sur deux est encore membre d’une des grandes Églises cantonales – et la base des membres continue de fondre rapidement »[2]. Une telle évolution a également des répercussions sur l’enseignement religieux à l’école. Car la manière dont la question de Dieu est posée est bien sûr aussi, et surtout, marquée par le type de religiosité personnelle. Lorsque l’évidence de la pratique religieuse (culte et prière, confessions et retraites, etc.) diminue ou disparaît complètement, le sentiment d’un enracinement sans question en Dieu s’évapore également. On remarque encore qu’il y a une camarade de classe ou d’université musulmane qui porte un foulard, ou un collègue de travail qui appartient à une église charismatique libre et qui passe donc ses week-ends à la communauté plutôt que sur le terrain de football ; mais on ne sait pas pourquoi ces gens font cela, et cela devient ainsi (comme le montre l’enseignement religieux) un objet d’intérêt culturel, comparable à l’intérêt que l’on porte à la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall, la brasserie du monastère de la Grande Chartreuse ou la cathédrale de Cologne : « Intéressant, mais pourquoi vrai ? ».
Ainsi, il me semble que la deuxième raison pour laquelle les thèmes résolument théologiques sont de moins en moins abordés dans les travaux de maturité mentionnés est désormais évidente : c’est sans doute parce que la revendication de la théologie, selon laquelle l’homme est capable de vérité au sens strict du terme, est de moins en moins facile à transmettre. – La vérité ? Pour beaucoup, c’est devenu un concept idéologique de combat dont on se tient le plus éloigné possible. La vérité n’existe, si tant est qu’elle existe, qu’au pluriel. Et c’est vrai : combien de mal n’a-t-on pas fait au nom de la vérité ? La vérité non seulement de Dieu et de l’Église, mais aussi du parti, de la politique, de la science, du progrès, etc. Mais peut-on pour autant oublier la question de la vérité ? Peut-on s’en passer ? Car que quelque chose se vérifie dans ma vie, qu’elle trouve une forme qui lui convienne, qu’elle s’ouvre à ce qui lui convient, à ce qui lui est prémédité… : quoi de plus beau que cela ? Et tout à coup, on se rend compte que « les vérités qui comptent dans une vie ne sont jamais acquises sans la complicité personnelle »[3]. Cela n’est pas moins vrai sur le plan philosophique que sur le plan religieux. Celui qui veut comprendre l’impératif catégorique d’Emmanuel Kant, par exemple, doit avoir une idée de l’inconditionnalité de la moralité originelle, sinon même les sermons moraux ne feront que l’intimider ; la dimension du « tu dois » catégorique lui restera fermée. Les modèles actuels d’enseignement religieux à l’école, qui s’efforcent de se tenir à équidistance la plus neutre possible de leur objet, sont-ils en mesure de toucher le nerf existentiel ? Sont-ils en mesure de transmettre un sens ? Un sens qui se fonde sur Dieu ? – Mais peut-être ne le veulent-ils pas. Peut-être que ce n’est pas non plus la mission de l’éducation publique. Transmettre un sens – : cela sent trop l’obligation et la religion.
Et pourtant, ce serait une perte énorme si la question des « vérités qui comptent dans une vie » n’était plus posée dans l’enseignement (religieux) scolaire. Aussi libéral qu’un tel enseignement puisse paraître, aussi ouvert au monde, émancipé et tolérant, il serait devenu insignifiant. La boussole intérieure aurait disparu d’un tel enseignement et, avec elle, l’idée d’à quel point l’être humain – tout être humain (que cela lui plaise ou non) – est fondé sur la vérité. Car chaque homme est une question, chaque homme est un seul grand « pourquoi », et pourtant nous ne pouvons pas répondre à ce « pourquoi » par nos propres moyens. Comment peut-on jamais épuiser un être humain ? Comment décrire de manière exhaustive qui je suis, qui tu es ? Chaque être humain est à la fois absolu et profondément relatif, c’est-à-dire qu’il se réfère à quelque chose de plus grand que lui. Et c’est ainsi que nous nous retrouvons une fois de plus face à la question de Dieu, non pas de manière indifférente, comme s’il était question de l’existence du calmar géant ou de la licorne, que l’on peut affirmer ou nier sans que cela nous touche particulièrement, mais avec ce pathos existentiel propre aux grands philosophes et théologiens – un Platon et un Aristote, un Thomas d’Aquin, un Kant, un Hegel, un Schopenhauer ou un Nietzsche ; tous feraient sans problème leurs des phrases comme celles qui suivent : « Dieu est soit un thème de l’humanité, soit pas de thème du tout » (Johann-Baptist Metz)[4]. « Ma vérité ne serait pas vérité si elle ne pouvait pas être vérité pour tous » (Thomas Pröpper)[5].
En revanche, un enseignement des religions ou des visions du monde qui n’oserait plus s’interroger sur ce qui est, mais uniquement sur ce que nous faisons des choses ; qui ne s’intéresserait plus à la vérité, puisque celle-ci est de toute façon inaccessible, mais aux diverses pratiques culturelles – : un tel enseignement pourrait certes nous sembler plus contemporain qu’un enseignement religieux de type classique. Et pourtant, il resterait faible. Car il penserait peu de l’homme – et donc peu des élèves ; il ne les prendrait pas au sérieux dans l’urgence de leurs questions ou n’aurait aucun intérêt à éveiller de telles questions en eux. En comparaison, une théologie de type classique, aussi pantouflarde soit-elle à première vue, apparaît comme nettement plus clairvoyante. Car elle démasque aussi bien la fausse humilité que le faux orgueil de ceux qui sont équidistants du point de vue idéologique. Là où l’on dénie à l’homme sa capacité à dire la vérité, on se place trop vite au-dessus des choses et de la vérité qui s’y exprime. Et c’est ainsi que l’on devient malgré soi ce « maître et possesseur du monde » que l’on n’apprécierait pas du tout d’être. – Peut-être, le temps reviendra où l’on nous donnera à nouveau à lire des travaux de maturité résolument théologiques.
Joachim Negel, Doyen
[1] Stephan Leimgruber, Von Kanton zu Kanton verschieden. Neue Ansätze des Religionsunterrichtes in der Schweiz, dans Herder Korrespondenz Spezial No. 2/2013, p. 48-52.
[2] Simon Hehli, Die gottlosen Heerscharen. Drei Millionen Menschen [in der Schweiz] gehören keiner Kirche an – eine heterogene Gruppe von Kampfatheisten, Esoterikern und religiös Indifferenten [Les armées impies. Trois millions de personnes [en Suisse] n’appartiennent à aucune église - un groupe hétérogène d’athées de combat, d’ésotéristes et d’indifférents à la religion.], dans Neue Zürcher Zeitung Nr. 34/245, samedi, 10 février 2023, p. 13.
[3] Thomas Pröpper, « ‚Wenn alles gleich gültig ist…’ Subjektwerdung und Gottesgedächtnis », dans Id., Evangelium und freie Vernunft. Konturen einer theologischen Hermeneutik [« “Si tout est valable de la même manière...” Devenir sujet et mémoire de Dieu », dans Id., Évangile et raison libre. Contours d’une herméneutique théologique], Fribourg-en-Brisgau et al., Herder, 2001, pp. 23-39, ici p. 24.
[4] Gotteskrise als Signatur der Zeit [La crise de Dieu, une signature des temps], dans Id., Memoria Passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Zeit, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 2006, p. 69-78, ici p. 70.
[5] Thomas Pröpper, Zur theoretischen Verantwortung der Rede von Gott. Kritische Adaption neuzeitlicher Denkvorgaben [La responsabilité théorique du discours sur Dieu. Adaptation critique de la pensée moderne], dans Id., Évangile et raison libre. Contours d’une herméneutique théologique (cf. note 3), p. 72-92, ici p. 74. – Similairement Wolfhart Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983, p. 15.