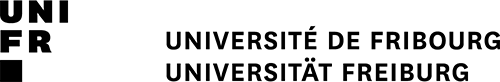Publié le 19.09.2024
Le mot du Doyen, Joachim Negel - SA 2024/I
Cher·è·s membres de la Faculté de théologie,
Chères amies et chers amis,
Une fois de plus, une année académique commence, et une fois de plus, on se retourne sur un été. C’était un été plein d’épiphanies. Le championnat d’Europe de football en Allemagne, les Jeux olympiques à Paris, puis les Jeux Paralympiques à Paris également. Entre deux, en juin et juillet, vingt et un concerts de Taylor Swift dans des stades en Europe dans le cadre de sa tournée mondiale de concerts « Eras » (rien qu’à Zurich, Gelsenkirchen, Hambourg et Vienne, 800'000 spectateurs en onze concerts ; les billets achetés en ligne se sont vendus en vingt minutes ; un million de fans sont repartis les mains vides). Plus récemment, Adèle, la reine de la pop britannique, à Munich ; là, dans un stade construit spécialement pour elle, dix méga-concerts en seulement dix jours, avec près d’un million de spectateurs, sans compter les badauds, une scène aussi grande qu’un terrain de football, le plus grand écran vidéo du monde, le show lumineux nécessitait sa propre centrale électrique ; les chaînes de télévision publiques faisaient des émissions spéciales jour et nuit.
Qu’est-ce qui nous arrive ? Tout cela est-il encore sain ? Ou, à l’inverse, est-ce la preuve du grand pouvoir de mise en scène d’une culture qui sait à quel point l’homme est homo ludens, un joueur qui a toujours besoin de jeux, que ce soit dans un bac à sable ou dans un stade olympique ?
Quelle que soit la position que l’on adopte face aux méga-événements énumérés, une chose est évidente : le sport et le théâtre sont les seules choses qui nous restent de l’Antiquité. Nous avons oublié le grec et le latin, Homère et Virgile, Thucydide et Cicéron ne sont peut-être plus connus que des spécialistes, mais le stade et la salle de concert sont des biens communs. Tout le monde les connaît. – Or, les performances théâtrales et les compétitions antiques étaient toujours des jeux en l’honneur des dieux. Nous oublions que les jeux panhelléniques étaient dédiés aux dieux de l’Olympe, d’où leur nom : Olympiades ! De même pour le théâtre. Les compétitions de tragédiens et de poètes, de chanteurs et de rhapsodes faisaient partie intégrante des fêtes des dieux grecs. Celui qui remportait le laurier était un laureatus, un élu des muses, un favori des dieux (baccalaureus est celui qui est couronné par le laurier divin).
Bien que les dieux antiques soient morts depuis longtemps, et que le Dieu biblique qui leur a succédé se soit retiré (sa présence ne se fait plus guère sentir, nous nous en passons très bien, du moins c’est ce qu’il semble), l’homme ne peut pas se passer du religieux – Friedrich Nietzsche, ce diagnosticien impitoyable de la modernité, avait raison une fois de plus (il suffit de penser à ce qu’il a dit sur la « naissance de la tragédie à partir de l’esprit de la musique » et sur la « grande santé », la dernière chose qui nous reste après la mort de Dieu). Et c’est ainsi que l’épiphanie succède à l’épiphanie et l’événement à l’événement. Les étoiles (c’est ainsi qu’on les appelle, « les stars ») naissent, les étoiles s’éteignent, le pays a besoin de nouveaux héros ; le superlatif d’hier est le diminutif de demain, et c’est ainsi qu’ils se surpassent, les héros, les titans, les dieux, citius, altius, fortius (« plus vite, plus haut, plus fort »), un battage médiatique chasse l’autre, un record poursuit l’autre ; ce qui ne peut être augmenté s’affaisse comme un ballon dégonflé. Sans l’ivresse, sans les dieux, sans les héros, nous nous rendrions compte de notre vide intérieur ; la régularité des jours serait à peine supportable.
Est-ce que c’est ce qui est si irritant dans notre culture postchrétienne ? Nous sommes éclairés jusqu’au bout et en même temps, comme les Grecs et les Romains de l’Antiquité, nous entretenons les cultes les plus bizarres (il suffit de penser aux raves technos à Zurich, à la Loveparade à Berlin, au festival Insomnia à Paris). Nous avons dit adieu aux dieux, mais nous ne pouvons pas nous débarrasser des fantômes. Et nous devons donc nous inventer de nouveaux dieux, ne serait-ce que pour l’ivresse de quelques jours ou de quelques heures. Une fois le feu d’artifice éteint, la vie quotidienne est de retour, mais elle est pénible. Et c’est ainsi que nous guettons le prochain engouement : où serait ce qui nous rendrait enthousiaste ? (Entendons-nous le son religieux de ce mot ?) Où trouver ce qui nous enivre, nous enchante, nous ravit ?
Bien sûr, ce qui nous bouleverse, nous fascine, nous attire est ambigu. Les transitions entre le divin et le démoniaque sont fluides, la Bible connaît ces liens. A l’ère des Jeux olympiques, de la Ligue des Champions de foot et des dieux du rock’n’roll, il serait bien de creuser davantage ces liens. Une faculté de théologie rendrait ainsi un véritable service à la société. Un regard éclairé par la connaissance de l’histoire des religions aiderait à prendre conscience de l’arrière-plan archaïque de notre culture. Un œil aiguisé par la prophétie biblique saurait décrire le caractère douteux d’une machine commerciale comme Taylor Swift. Et la connaissance de l’histoire de la liturgie et des rituels chrétiens permettrait d’aborder un spectacle comme la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris avec un sourire indulgent. En bref, on ne se rendrait pas seulement compte de la grandeur de notre culture ; on se rendrait également compte de son ambivalence, sans pour autant devoir la condamner ; on pourrait l’aborder de manière créative, en comprenant que ni une moralisation râleuse ni une acclamation affirmative ne rendent justice aux choses. (Les réactions vexées des évêques français face au spectacle d’ouverture des Jeux olympiques à Paris étaient tout simplement déplorables, comme si le pauvre metteur en scène avait voulu « heurter les sentiments religieux » ; il avait envie de tout autre chose. Et les « célébrations Taylor Swift », comme celles organisées récemment dans quelques paroisses protestantes, ne sont pas non plus très éclairées ; la musique de cette dame est trop plate, les paroles sont banales, et le message, si tant est qu’il y en ait un au-delà de la simple autopromotion, n’est pas très saisissable).
Ce sont des réflexions de ce genre, chers membres de la Faculté de théologie, chères amies et chers amis, qui me viennent à la fin de cet été surchargé. Qu’il est bon que l’été se termine, qu’il est bon que le semestre commence enfin, que le football, les Jeux olympiques et les concerts de Taylor Swift n’occupent plus nos pensées, mais que le travail sobre des cours, des séminaires et des colloques s’impose. Profitez d’un agréable temps de travail !
Mes salutations les plus cordiales,
Joachim Negel