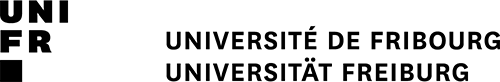Publié le 31.12.2024
Le mot du Doyen, Joachim Negel - SA 2024/III
Mot du Doyen
… et je suis à ce moment-là si loin de penser que mes lignes sont puériles ou même ridicules que j’ajoute pour finir une demi-phrase en demandant au bon Dieu de me laisser rendre justice aux personnes que j’ai rencontrées. Car je sais maintenant que nos excursions ne s’arrêteront pas là, mais que nous ne sommes qu’au début de notre voyage et que je vais le raconter.
C’est sur ces mots, chers membres de la Faculté de théologie, chers amis, que s’achève un livre étonnant, hautement adventiste. Il s’intitule Bannmeilen. Ein Roman in Streifzügen [Banlieues. Un roman en randonnées, excursions, flâneries, balades, pérégrinations]. Il est écrit par Anne Weber, une écrivaine allemande qui vit à Paris depuis quarante ans et qui s’est fait un nom avec ses traductions du français vers l’allemand et inversement[1]. Anne Weber est ce que l’on peut appeler une passeuse de frontières constante entre les langues et les mondes. Et des frontières, il y en a beaucoup. C’est ce que raconte son livre. En compagnie de Thierry, un ami cinéaste et photographe issu d’une famille franco-algérienne et qui a grandi en banlieue parisienne, la narratrice parcourt pendant des mois ces cités parisiennes à moitié construites et à moitié détruites, ces zones industrielles, commerciales et des friches, que l’on appelle la « banlieue », et qui se trouvent en dehors du boulevard périphérique, cette autoroute à six ou huit voies qui sépare presque hermétiquement le Paris historique, touristique et bourgeois du monde des quartiers sensibles, des cités-ghettos délabrées et des habitations de migrants.
« Où finit la ville et où commence la banlieue est clairement défini à Paris », écrit Anne Weber, « il n’y a pas de transitions fluides »[2]. Et c’est ainsi qu’à peine sorti des terminus du métro, on se retrouve dans un monde différent du Paris de Montmartre, de la Tour Eiffel, de l’Île de la Cité et du Boulevard Saint-Germain. Et pourtant, c’est aussi Paris, mais celui que l’on ne connaît pas. Ici, les gens se débrouillent pour vivre juste en dessous du seuil de pauvreté : mauvaises écoles, mauvaise formation, taux de chômage élevé, criminalité liée à la drogue. Des lieux de rencontre où des hommes attendent du matin au midi des emplois sur des chantiers. Entre les deux, des centres commerciaux et des hôtels B&B, des ponts d’autoroute sous lesquels se trouvent de petites mosquées et des abattoirs halal, des lotissements de maisons mitoyennes inhospitalières. Puis à nouveau des décharges que personne ne nettoie (« Pourquoi est-ce que j’attends de gens qui doivent vivre dans de telles boîtes en béton à côté de l’autoroute qu’ils se préoccupent de la propreté et de l’ordre de leur environnement ? »[3]). Ici et là, des épaves de voitures brûlées qui témoignent des émeutes qui éclatent de temps à autre. (On n’oubliera pas la phrase marquante de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, qui voulait nettoyer la banlieue de cette vermine au Kärcher)[4]. La population française « autochtone » est partie depuis longtemps. Les habitants actuels se composent de ressortissants des anciennes colonies, du Maghreb, de divers pays africains, du Liban, etc.
Ce monde que l’œil du touriste percevrait comme inintéressant, voire laid, est décrit par Anne Weber avec un regard précis et fin, avec une grande attention à la folie, à l’absurde puis à la drôlerie envoûtante, à la tendresse de la vie. Ici, rien n’est enjolivé, rien n’est démasqué. Ici, on montre avec précaution ce qui est.
La narratrice se montre irritable à plusieurs reprises. Que dire de ce cygne en plastique rose qui couronne un tas d’ordures ? Et que dire de ces caddies piqués au supermarché et transformés en stands de barbecue sur lesquels sont proposées des brochettes de poulet ? Plus le temps passe, plus la narratrice perd l’habitus bourgeois de ceux « qui vivent à l’intérieur » (intra muros)[5], dans les beaux arrondissements parisiens. Son compagnon Thierry, franco-algérien et lui-même habitant « entre deux ailleurs »[6], l’emmène dans ces « mondes intermédiaires »[7] de la banlieue qu’aucun guide touristique ne répertorie. Plus elle pénètre dans ce monde, plus elle découvre non seulement l’histoire coloniale française avec ses conséquences tardives très douteuses ainsi que l’histoire allemande, par exemple sous la forme de la Cité de la Muette à Drancy, d’où partaient les convois des Juifs français vers les camps d’extermination pendant la Seconde Guerre mondiale – elle se découvre de plus en plus elle-même comme coincée entre les deux pays et les deux cultures. Elle aussi, la narratrice, vit « entre deux ailleurs »[8], mais elle ne le savait pas jusqu’à présent. C’est la plurivocité des habitants de la banlieue qui le lui apprend.
Si elle a pu apprendre cela d’eux, elle le doit non seulement à son guide Thierry, mais aussi et surtout à un lieu très particulier : le café Le Montjoie et son patron Rachid[9]. Le Montjoie : le nom est tout à fait approprié. Ce café est « un refuge »[10] pour les échoués de la banlieue, une oasis au milieu de cet enchevêtrement d’autoroutes, de façades d’immeubles inhospitalières, de stations-service, d’incinérateurs de déchets, de discounters et de parkings. Rachid, le patron discret et réservé du café, ne demande pas d’où l’on vient, ni où l’on va, ni pourquoi on a atterri ici ; il émane de lui un calme bienfaisant. À la troisième ou quatrième visite de ses nouveaux clients, il passe imperceptiblement au « tu » confidentiel. – Et puis le public du Montjoie ! Quel éventail de personnes et de destins : Jésus, le marchand de journaux espagnol qui gagne quelques euros en plus de sa maigre retraite (en espagnol : jubilación) ; un vieillard anonyme qui, suite à une opération du larynx, ne peut plus avaler et s’injecte du vin directement dans l’estomac au moyen d’une seringue et d’un tuyau (Rachid lève allusivement un verre invisible et trinque discrètement avec ce buveur gastrique) ; un demi-muet fumeur de chaînes qui joue aux dominos pendant des heures ; un jeune anarchiste qui ne vient jamais qu’ « en compagnie de son smartphone »[11] ; un Marocain qui n’aime pas les Tunisiens, car il est bien connu que les Marocains sont plus intelligents que les Tunisiens ; des personnes d’origine algérienne qui se tiennent au comptoir à côté d’anciens combattants français et qui peuvent se parler, même si les conversations tournent à vide (mais au moins, on se parle). Entre tout cela, deux éboueurs Noirs qui font une pause dans le café de Rachid ; une vieille femme juive qui vote pour le Rassemblement National. Et puis, toujours, la mère de Rachid, « la maman », qui accueille chaque client avec un sourire, comme s’il était son petit-fils préféré. La « vie [...] de Rachid consiste à offrir un refuge aux perdus, aux solitaires, aux malades du quartier et à joindre les deux bouts »[12]. Il ne gagne pas beaucoup avec son magasin, mais qu’importe. Sans lui, ses clients seraient sans domicile fixe ; plus d’un aurait péri depuis longtemps dans la solitude et la tristesse[13].
Est-il exagéré de dire que ce café, qui semble venir d’un autre temps, a quelque chose de l’étable de Bethléem où la Sainte Famille a trouvé refuge – et la banlieue parisienne en général, de l’Égypte où le Messie, à peine né, a dû s’enfuir ? Les pérégrinations d’Anne Weber dans un monde en désordre amènent le lecteur à des idées de Noël aussi étranges : tant qu’il y aura des gens comme Rachid et sa maman et un café comme Le Montjoie, le monde ne pourra pas aller complètement à vau-l’eau.
Dans le chapitre d’introduction de son roman, Anne Weber écrit qu’elle a « vécu pendant des décennies à proximité immédiate d’un monde étranger […] sans lui porter le moindre intérêt. J’avais voyagé sur des continents lointains, exploré des villes et parcouru des îles, mais j’étais restée aveugle à l’étranger et à l’autre à proximité immédiate »[14]. La fin du roman montre à quel point ces excursions l’ont transformée, lorsque la narratrice éprouve le désir soudain de retourner une nouvelle fois dans la grande église Saint-Yves, fréquentée par la communauté tamoule, l’un des nombreux édifices religieux que l’on avait placés au milieu des nouveaux quartiers dans les années 1930, puis une nouvelle fois après la guerre dans les années 1960, alors que la pratique religieuse était déjà massivement en déclin. Ça lui demande de feuilleter encore une fois le grand livre des remerciements et des intercessions, comme elle l’avait fait lors d’une de ses précédentes ballades[15]. Et c’est ainsi que ce « roman en errances » se termine par les mots suivants :
Nous entrons dans l’église. Elle est vide, à l’exception de deux femmes assises sur des bancs éloignés, la tête baissée. Je m’approche du petit autel latéral à gauche et, pour ne pas me faire remarquer pour ce que je suis ou crois être, c’est-à-dire une personne qui ne vient ici que pour profaner par sa curiosité éhontée les demandes et les confessions les plus intimes d’inconnus, je fais semblant – le dos tourné à la nef pour que Thierry ne me voie pas – de prier. Et voilà qu’au bout d’un moment, je prie. Il n’est pas nécessaire d’apprendre à prier. Il n’est même pas nécessaire d’être croyant pour cela. Je m’approche alors du pupitre avec le livre ouvert et je vois sur les pages ouvertes une série d’entrées qui semblent avoir été faites par des enfants :
Sana : Bonjour à tous je dois travailler je dois avoir bonne note et je dois devenir docteur et je dois avoir de l’argent. Merci au revoir à tous les dieux.
Samantha : je dois travail je dois grandir je dois bonne note et je dois avoir beaucoup argen
Une date, sans nom [biffé] je veux que [biffé] nous obtenions le visa. Et aussi [biffé] les yeux de ma petite sœur ouvrent bien.
Avant cela, de nombreuses entrées en tamoul, et je me plonge dans l’écriture ronde, parfois avec de petits crochets vers le haut ou vers le bas, mais sinon comme en majuscules régulières, au-dessus desquelles flottent de petites taches ou des ronds. L’une de ces entrées énigmatiques se termine par trois points d’exclamation, et je me dis : peut-être que ce que je pourrai raconter de nos longues randonnées n’est rien d’autre qu’un mystère transmis avec insistance.
Et sans que je l’aie prévu ni même envisagé une telle possibilité, je prends soudain le stylo posé sur le pupitre et je veux écrire quelques lignes en français sous celles des élèves, mais je m’arrête encore une fois un instant, car je réalise que tout le monde pourra lire mon entrée, puis je me ravise et j’écris en allemand : Bon Dieu, protège s’il te plaît ... jusqu’à ce que je parvienne, en partant de mes êtres les plus chers, à Rachid et à sa petite communauté de bar, aux habitants des bretelles d’autoroutes et des villages de tôle ondulée, des blocs de béton et des maisons murées, et finalement à tout le département, et je suis à ce moment-là si loin de penser que mes lignes sont puériles ou même ridicules que j’ajoute une demi-phrase à la fin, en demandant au bon Dieu de me permettre de rendre justice aux gens que j’ai rencontrés et à Thierry, et de réussir mon récit. Car je sais maintenant que nos excursions ne s’arrêteront pas là, mais que nous ne sommes qu’au début de notre voyage et que je vais le raconter[16].
Oui, chères et chers membres de la Faculté de théologie, chers amis et amies, nous ne sommes, nous aussi, qu’au début de notre voyage, et où il nous mènera, si nous aussi nous trouverons un café comme celui de Rachid où l’on nous accueille, ou si nous aurons un guide comme celui de Thierry – tout cela est écrit dans les étoiles. Mais quand même, dans les étoiles. Qu’elles nous éclairent avec douceur en cette période. Je vous souhaite, à vous et à ceux qui vous sont chers, un Noël béni.
Joachim Negel
Doyen
[1] Concernant l’auteur, voir les entrées sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Weber et https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Weber_(auteur). – Dans ce qui suit, nous citons Anne Weber, Bannmeilen. Ein Roman in Streifzügen, Matthes & Seitz, Berlin, 2024 (citation ibid., p. 301).
[2] Ibid., p. 8.
[3] Ibid., p. 21.
[4] Ibid., p. 13 s.
[5] Ibid., p. 8.
[6] Ibid., p. 215.
[7] Ibid., p. 279.
[8] Cf. ibid., p. 91-93, 107 s.
[9] Ibid., p. 50-53 ; 111-116 ; 139-144 ; 194-201 ; 212-221 ; 237-251 ; 284-293.
[10] Ibid., p. 217.
[11] Ibid., p. 79.
[12] Ibid., p. 216.
[13] Ibid., p. 292.
[14] Ibid., p. 10.
[15] Ibid., p. 181-184.
[16] Ibid., p. 299-301.