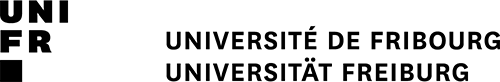Publié le 04.03.2025
Le mot du Doyen, Joachim Negel - SP 2025/I
Chers membres de la Faculté de théologie,
Chères amies et chers amis,
Pour certains, il s'agit d'une sorte d'événement salvateur ; pour d'autres, il s'agit de la chute par excellence ; pour d'autres encore, il s'agit du prix à payer pour un rapprochement sans doute difficile, mais inévitable, des Églises chrétiennes encore jeunes avec la réalité politique de la société de l'Antiquité tardive : il s'agit de ce que l'on appelle le « tournant constantinien ». Avec le concile de Nicée, dont nous fêtons cette année le 1700ème anniversaire, il est à nouveau sur toutes les lèvres. – Concile de Nicée ? Tournant constantinien ? Politique religieuse des empereurs romains ? De quoi s'agissait-il à l'époque, il y a 1700 ans ? Et pourquoi « Nicée » est-il si important (au-delà des questions dogmatiques qui y ont été traitées) que nous devions le commémorer ?
Eh bien, la raison en est que c'est dans les années qui ont précédé et suivi « Nicée » qu'ont été posés les jalons qui marquent encore aujourd'hui le rapport entre la théologie et la philosophie d'une part, et le rapport entre l'État et l'Église ou la religion et la société d'autre part. En effet, le fait qu'une société se considère comme « laïque », c'est-à-dire qu'elle se fonde sur elle-même et non sur une légitimation divine, peut certes paraître évident au XXIème siècle, mais ne l'est en aucun cas d'un point de vue historique. Car pour les sociétés prémodernes, la langue et la culture, le théâtre, la littérature et l'art, l'économie et le pouvoir étatique étaient toujours imprégnés, voire sanctionnés, par la religion. C'est pourquoi le culte public revêtait une telle importance. C'est en lui que la société s'assurait de sa pérennité, garantie par les dieux, à travers les générations. Car comment l'empereur et ses fonctionnaires pourraient-ils bien gouverner si la divinité ne leur donnait pas sa bénédiction ? Comment un empire pouvait-il subsister s'il n'était pas, dans ses fondements, le reflet du cosmos divin ? Comment réussir une vie humaine (en termes de travail, de santé, de descendance) si les dieux ne lui étaient pas favorables ? En bref, pour l'homme prémoderne, toute autorité humaine se fonde sur une altérité à laquelle l'homme n'a pas accès : la souveraineté des dieux, en latin/préromain : des superani (d'où le terme « souveraineté »). Remettre en question la souveraineté des dieux serait de l'hybris ; cela reviendrait à défier le destin.
En dépit de toutes les différences importantes qui existent entre l'histoire des mentalités et les sociétés prémodernes, de telles réflexions ne nous sont peut-être pas totalement étrangères : personne n'est l'artisan de son propre bonheur, c'est pourquoi il faut toujours une aide supérieure pour que la vie n'échoue pas. Cela vaut pour l'État comme pour l'individu, et cela de manière plus ou moins constante depuis la fin de l'Antiquité jusqu'à la Révolution française. Il était donc naturel qu’en 313, les empereurs romains Constantin et Licinius accordent la liberté de culte au jeune christianisme, qui, bien que minoritaire, était devenu une puissance à prendre au sérieux, avec l’édit de tolérance, aussi appelé édit de Milan. Les persécutions contre les chrétiens devaient cesser ; chacun devait sacrifier en paix à ses dieux, pour autant qu'il ne mette pas la paix publique en danger – et plus encore : pour autant qu'il contribue à la paix publique. Et c'est ce que l'on faisait en priant pour l'empereur.
L'« accord de Milan », véritable nom de l'édit de tolérance, a ramené le calme dans les communautés chrétiennes agitées, même si l'on n'avait pas vraiment confiance en ce calme. On avait été trop souvent trompé ; trop souvent, des périodes de répression sanglante avaient suivi des périodes de calme paisible. Ce n'est que douze ans après l’« accord de Milan », avec le concile de Nicée, que le vent semble avoir définitivement tourné en faveur des chrétiens. Car c'est l'empereur lui-même qui avait initié cette rencontre à laquelle étaient invités les évêques « de toute la terre » (epì tēs oikoumenēs). Les évêques pouvaient utiliser la poste impériale pour leur voyage ; chaque évêque avait le droit d'amener avec lui trois conseillers théologiques et deux diacres – pour un peu plus de 300 pères conciliaires, cela représentait bien 2000 personnes ; les évêchés et les diocèses n'étaient guère équipés pour mettre à disposition l'infrastructure nécessaire. C'est pourquoi le concile s'est tenu dans la propriété impériale d'été de Nikaia (Nicée ; aujourd'hui Iznik), située à proximité de la capitale de l'empire, Byzance ou Constantinople (aujourd'hui Istanbul). Les évêques y disposaient de toutes les commodités nécessaires à un événement d'une telle ampleur.
Les raisons de la générosité de Constantin sont probablement multiples. Il est certain que l'empereur n'agissait pas déjà en fonction d'une foi personnelle en Christ ; le fait que Constantin ne se soit fait baptiser que sur son lit de mort, et de surcroît par un prêtre arien, ne plaide pas en faveur d'une profonde piété catholique. Néanmoins, comme « la plupart des personnes cultivées depuis l'époque hellénistique »[1], il a probablement troqué depuis longtemps le polythéisme mythique de son environnement païen pour un mono- ou un hénothéisme philosophiquement réfléchi. Tout cela l'a rapproché de la foi biblique en Dieu. En même temps, « il s'est probablement dit que si le christianisme avait pu s'enraciner dans tout l'empire malgré tant de résistances, il devait y avoir en lui quelque chose que les anciens cultes n'avaient pas »[2]. En bref, on voyait de plus en plus dans les Églises, encore relativement faibles en nombre (à peine dix pour cent de la population était chrétienne), une avant-garde sociale que l'on admirait, notamment en raison de son radicalisme éthique, et que l'on commençait donc à prendre au sérieux – même du point de vue politique. En ce sens, les affirmations qui circulent actuellement, selon lesquelles Constantin était un politicien cynique et calculateur qui aurait usurpé politiquement le potentiel spirituel du jeune christianisme, tandis que les évêques auraient bradé la vérité prophétique du Christ pour le plat de lentilles d'une auto-impérialisation cléricale, sont absolument incongrues. Répétons-le : les sociétés de l'Antiquité tardive étaient religieuses de part en part et le pouvoir politique était donc naturellement aussi connoté religieusement. « L'idée d'un État nécessairement neutre sur le plan religieux face à une société pluraliste » – une idée évidente pour nous autres postmodernes d'aujourd'hui – « est anachronique pour le début du quatrième siècle »[3].
Il est néanmoins nécessaire de s'interroger sur le prix à payer pour que l'Église ou les Églises se rapprochent de la réalité politique de la société de l'Antiquité tardive. C'est ainsi : celui qui accepte d'être agréé par la société se rend commun, de quelque manière que ce soit. Ainsi, la nouvelle relation entre l'État et l'Église, telle qu'elle a été initiée sous Constantin et Licinus en 313 et qui a finalement atteint son apogée en 380 avec la proclamation du christianisme comme seule religion d'État dans l'Empire romain, a également eu un prix. Même si les conditions de vie des petits et des insignifiants s'améliorèrent (les nouveau-nés ne pouvaient plus être abandonnés, les esclaves ne pouvaient plus être marqués au fer rouge, la crucifixion comme peine de mort fut abolie, le dimanche devint un jour férié général, le statut juridique des femmes changea à bien des égards pour le mieux[4]), la proximité de l'État signifiait toujours aussi la tentation du pouvoir. Et c'est là que s'applique la cruelle maxime : « Le pouvoir tend à corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument »[5]. Après des décennies de persécution, certains évêques se sont réjouis de la reconnaissance que leur accordaient les autorités de l'État : être compté parmi les notables de la ville, être exempté d'impôts, ne pas devoir faire de service militaire, être nommé à des fonctions étatiques comme conseiller, juge, etc. Et comme ces nouvelles conditions de vie plaisaient, on plaisait aussi à l'Etat. Comment pourrait-il en être autrement ?
Mais n'avait-on pas commencé par là à trahir la pensée radicale de Jésus de Nazareth à propos du royaume ? La parole de Jésus à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde » (Jn 18,36) ne signifie pas en effet que le royaume de Dieu se trouve quelque part dans les cieux, mais qu'il est diamétralement opposé aux conditions non rachetées de ce monde : « Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi… » ! (Mt 20,26) : Que reste-t-il de cette force anarchique qui guérit à la racine l'absence de sainteté du monde ? – Un patriarche Cyrille qui se jette sans retenue dans les bras du néo-impérialisme de Poutine ? Une « New-Born-Christianity » évangélique qui voit dans un président Trump le Messie envoyé par Dieu lui-même (« Jesus is my Saviour and Donald Trump is my President ») ? – On en a la bave aux lèvres et on aurait très envie de remettre fondamentalement en question « Nicée » et le « tournant constantinien ». N'aurait-il pas mieux valu se tenir dès le départ à l'écart de l'État, ce « Léviathan » séduisant (Th. Hobbes) ? Ne se serait-on pas laissé compromettre par les tentations du pouvoir ? Ne serait-on resté immaculé et pur ?
On pourrait poser la question ainsi et avoir l'indignation morale de son côté. Mais qu'aurait-on gagné à le faire ? Pas grand-chose. Peut-on sérieusement souhaiter que les Églises, comme le demandent les groupes catholiques de droite et les mouvements du renouveau charismatique, se tiennent à l'écart de tout, cultivent leur intériorité et attendent le royaume de Dieu promis, qui viendra à la Saint-Glinglin ?
Pour faire court : Il est anachronique de déplorer le « tournant constantinien » comme la grande chute dans le péché. Après 2000 ans d'inculturation chrétienne en Europe, les champs entre l'État et l'Église, la religion et la société sont bien trop étroitement imbriqués pour cela. Imaginons que ces liens n'aient pas existé – que se passerait-il alors ? Sans le « tournant constantinien », il n'y aurait pas de cathédrale de Cologne ni de Chartres : il n'y aurait pas de Summa Theologiae, pour laquelle un système universitaire européen est nécessaire ; il n'y aurait pas de Messe en si mineur de Bach (car pour celle-ci aussi, il faut des écoles de musique, des orchestres et des chœurs soutenus par l'État ou par des citoyens). Mais il n'y aurait pas non plus de Kant, Schelling, Hegel et Fichte, qui ont tous grandi dans l'environnement de presbytères protestants. Il n'y aurait pas de Friedrich Nietzsche. Il se pourrait même qu'il n'y ait pas de Nouveau Testament (l'empereur Constantin avait fait produire 50 bibles complètes, un exploit historico-culturel qui occupa les principaux monastères de son empire pendant des années ; le « Codex Sinaiticus » est le seul exemplaire de cette commande d'État qui nous soit parvenu dans son intégralité, et il était si coûteux que l'empereur ne pouvait pas même le payer avec son trésor personnel)[6]. Il n'y aurait même rien du riche héritage de l'Antiquité (Platon, Homère, Cicéron ou Virgile), car tout cela a été transmis au fil des siècles dans les scriptoriums des monastères européens par des dizaines de milliers de moines copistes anonymes. Mais les monastères ont besoin de sponsors, notamment de l'État. Nous ne pouvons même pas imaginer à quoi ressembleraient l'Europe et la moitié du monde sans cette époque critiquée comme « constantinienne ». Sans compter qu'il est insensé pour une faculté de théologie d'une université d'État de diffamer à propos de l'imbrication de l'État et de l'Église. On critique une relation dont on vit soi-même volontiers et confortablement.
Et c'est ainsi qu'au terme de toutes ces réflexions, plusieurs questions se posent : que reste-t-il de cette interdépendance « constantinienne » telle qu'elle a commencée il y a 1700 ans ? Quels sont nos fondements spirituels face à la sécularisation croissante de la société due à la technologisation, à l'économisation et à la numérisation ?
On peut poser les questions avec encore plus d'acuité : d'où l'État laïc tire-t-il sa légitimité ? Certainement plus selon la volonté de Dieu, même si la plupart des constitutions nationales européennes continuent de commencer par l'invocatio Dei : « Au nom de Dieu tout-puissant » (comme la Constitution fédérale de la Confédération suisse dans sa version de 2008 actuellement en vigueur) ; « En responsabilité devant Dieu et les hommes » (comme le préambule de la Constitution de la République fédérale d'Allemagne de 1949). Mais si ce n'est plus de la volonté de Dieu, d'où l'État laïc tire-t-il sa légitimité ? De la volonté du peuple ? Des succès de l'économie ? De la beauté des cultures nationales respectives ? – On voit bien à quel point tout cela est douteux. Et si la volonté du peuple s'exprimait de manière disruptive ? (« Make America great again ! »). Si de graves récessions économiques surviennent ? (« Alles für Deutschland ! »). Si l'amour de son propre pays se transforme en chauvinisme ? (« Les étrangers dehors ! » ). – Et bien, que se passerait-il alors ?
Certes, il y a encore les droits de l'homme universels et le droit à l'épanouissement individuel, sur lesquels les États laïques d'Europe s'accordent. Mais tout cela est plus que fragile, ne développe plus la force de cohésion émotionnelle nécessaire, comme le montrent notamment les résultats des élections dans les différents pays européens. Existe-t-il encore un fondement sur lequel pourrait s'épanouir une vision du monde qui unisse les différents groupes sociétaux ? Autrefois, le christianisme offrait une telle base, ainsi qu'un horizon transcendant qui dépassait tous les antagonismes étatiques et individuels. En dépit de tous les développements problématiques, c'était l'exploit éminent de ce que l'on appelle le « tournant constantinien ». Les bouleversements actuels en Russie et aux États-Unis, mais aussi dans l'ensemble des sociétés occidentales, qui donnent le vertige, montrent clairement que cette cohésion n'existe plus. C'est ce qui est inquiétant, et c'est ce que nous rappellent les célébrations du 1700ème anniversaire de « Nicée ». Trouver comment gérer cette situation serait une tâche à laquelle toutes les facultés d'une université devraient s'atteler, notamment la faculté des lettres et la faculté de théologie. Les bouleversements actuels quasi vertigineux en Russie et aux États-Unis, mais aussi dans l'ensemble des sociétés occidentales, montrent clairement que cette parenthèse n'existe plus. C'est ce qui est inquiétant, et c'est ce que nous rappellent les célébrations du 1700e anniversaire de « Nicée ». Trouver comment gérer cette situation serait une tâche à laquelle toutes les facultés d'une université devraient s'atteler, notamment la faculté de philosophie et la faculté de théologie. C'est là leur mission éminemment sociale. Car, pour ne citer que cela, la crise de l'Eglise dont on parle partout dans les milieux ecclésiastiques fait partie d'une crise spirituelle bien plus large de nos sociétés européennes dans leur ensemble. Comme les chrétiens font partie de la société, ce qui affecte la société les affecte aussi. Qui sommes-nous au juste ? Et qui voulons-nous être ? Le 1700e anniversaire de Nicée pourrait peut-être être l'occasion d'une réflexion plus approfondie à ce sujet.
Joachim Negel
Doyen
[1] Albrecht Dihle, « Zur spätantiken Kultfrömmigkeit », dans : Jahrbuch für Antike und Christentum (JAC. E 8), 1980, p. 43.
[2] Paul Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien (312 – 394), Albin Michel, Paris, 2007, p. 69.
[3] Karl Baus, « Von der Urgemeinde zur frühchristlichen Großkirche », dans : Hubert Jedin (éd.), Handbuch der Kirchengeschichte, Freiburg i.Br., 1985, vol. I, p. 68-479, ici : p. 477.
[4] Cf. Les passages correspondants dans Arnold Angenendt, Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert, Münster, 2007.
[5] Cf. La célèbre phrase de Lord Acton dans une lettre à Mandell Creighton, le 5 avril 1887, à l'occasion de la définition de l’infaillibilité et de la primauté de juridiction de l'évêque de Rome : « Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely ».
[6] Cf. Eusèbe de Césarée, De vita Constantini, lib. 4, cap. 36,2.