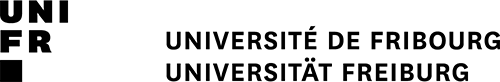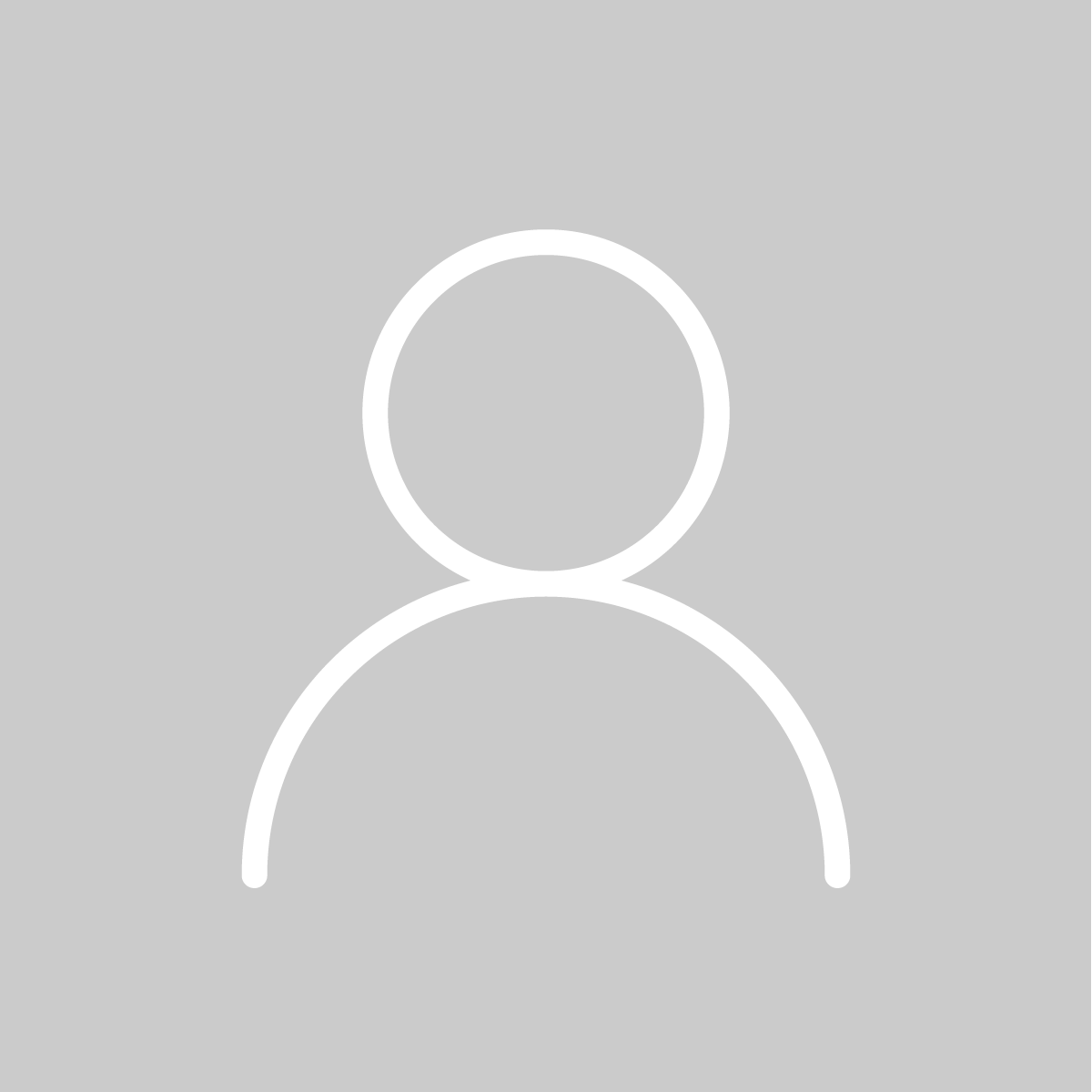Topic tbc, Walther Schücking Lecture in International Law
Samantha Besson,
Université of Kiel
(20.11.2025) | Conference
Dangerous Science, Anticipation and the Human Right to Science
Samantha Besson,
Guest lecture at the Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law, Freiburg
(17.10.2025) | Conference
Property in Outer Space, An Introduction. The Province of All Mankind ? Property in Outer Space.
Samantha Besson,
Perspectives in Public and Private International Law and Political Philosophy Conference, Collège de France, Paris
(25.9.2025) | Conference
In What Sense are International Organizations Public ?
Samantha Besson,
Empowerment and Accountability: Private versus Public Power workshop, Reid Hall, Columbia University in Paris
(29.6.2025) | Conference
Génocide. Droit et histoire du crime des crimes, Introduction
Samantha Besson,
Génocide. Droit et histoire du crime des crimes Conférence, Collège de France, Paris
(13.6.2025) | Conference
Reply to Bruno Karsenti, 'Nous autres européens. Dialogue avec Bruno Latour'
Samantha Besson,
Institut des civilisations, Collège de France, Paris
(10.1.2025) | Conference
The Law of International Organizations
Samantha Besson,
United Nations Audiovisual Library of International Law, Lecture Series, Spring 2024
(2025) | Conference
The Law of International Organizations
Samantha Besson,
United Nations Audiovisual Library of International Law
(2025) | Conference
General Principles in EU External Relations Law: The Case of Equity
Samantha Besson,
General Principels in EU External Relations Law conference, Asser Institute, The Hague
(6.12.2024) | Conference
The Institutional Guarantee of the Human Right to Science
Samantha Besson, Human Rights Law Review (2024) | Journal article
In What Sense are International Organizations Public ?
Samantha Besson,
Lecture, University of Leiden
(4.12.2024) | Conference
Panelist: La diplomatie climatique
Samantha Besson,
Cité de la réussite, La confiance, Collège de France & Sorbonne, Paris
(23.11.2024) | Conference
Prendre le droit de l'Homme à la science des femmes au sérieux
Samantha Besson,
La science et le genre, colloque de rentrée du Collège de France, Paris
(18.10.2024) | Conference
Distributive Justice in International Law
Samantha Besson,
Conference co-organized with Jorge Vinuales and Martti Koskenniemi in the framework of the 10th and 16th Commissions of the International Law Institute, LUISS, Rome
(4.10.2024) | Conference
Equity in International Law
Samantha Besson,
Distributive Justice in International Law Conference, LLUIS Guido Carli, Rome
(3.10.2024) | Conference
L'équité en droit international
Samantha Besson,
Annual Conference of the Société française pour la philosophie et la théorie politiques et juridiques, University of Strasbourg
(26.9.2024) | Conference
International Cooperation under the Human Right to Science. Grounds, Subjects, Objects and Content
Samantha Besson,
International Cooperation under the Human Right to Science conference, Université de Fribourg, Switzerland, 5-6 September 2024
(5.9.2024) | Conference
What can public international law do against privatisation?
Samantha Besson, Transnational Legal Theory (2024) | Journal article
Les espaces du droit international en voie d'appropriation. Réinstituer les communs pour éviter l'enclosure
Samantha Besson,
Session de clôture, Festival Histoire à venir, Toulouse
(26.5.2024) | Conference
L'égalité devant la loi internationale
Samantha Besson,
Festival Histoire à venir, Toulouse
(25.5.2024) | Conference
'Le droit international comparé de l'Etat', Le concept d'Etat à travers les civilisations conférence, University of Lyon 3
Samantha Besson,
(23.5.2024) | Conference
La science, un droit de l'Homme ?: Conférences inaugurales de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
Samantha Besson (Swiss Academies Communications, Bern, SAGW, 2024)
| Book
'The Human Right to Science' qua Right to Participate in Science and Enjoy its Benefits. The Participatory Good of Science and its Human Rights Implications'. (2023)
Samantha Besson, International Journal of Human Rights, DOI: 10.1080/13642987.2023.2251897 (2024) | Journal article
'La souveraineté en et de droit international: Petit exercice de démystification', Catholic University of Louvain
Samantha Besson,
(25.4.2024) | Conference
'Democratic Representation in and by International Organizations', Columbia University Law School, New York
Samantha Besson,
(18.4.2024) | Conference
'The Public-Private Relation and International Law', Columbia University Law School, New York
Samantha Besson,
(11.4.2024) | Conference
Anticipation under the Human Right to Participate in Science: Concepts, Stakes and Specificities' special issue on Anticipation under the Human Right to Science, 293-496
Samantha Besson, International Journal of Human Rights (2024) | Journal article
'The Politics of Regional International Organizations: A New Dawn for the Political Legitimacy of International Law'
Samantha Besson, International Organizations Law Review (2024) | Journal article
The International Law of Regional Organizations: Mapping the Issues, with Eva Kassoti
International Organizations Law Review (2024) | Journal article
Pour une représentation démocratique multiple au sein de l'Organisation mondiale de la santé, in de Frouville, O and Rousseau, D. (eds), Démocratiser l'Espace-Monde, Paris: Mare & Martin 2024, 199-218
Samantha Besson (2024)
| Book chapter
'La souveraineté en et de droit international. Petit exercice de démystification'
Samantha Besson, Annuaire suisse de droit européen, 407-420 (2024) | Journal article
Pour une représentation démocratique multiple au sein de l'Organisation mondiale de la santé
Samantha Besson (2024)
| Book chapter
'The Human Right to Participate in Science and the Legal and Institutional, Structure of Science', University of Uppsala
Samantha Besson,
(19.12.2023) | Conference
'Democratic Representation in, through and by International Organizations', University of Uppsala
Samantha Besson,
(15.12.2023) | Conference
'What can International Law do against Privatization?', University of Uppsala
Samantha Besson,
(12.12.2023) | Conference
La souveraineté en droit international: passé, présent, avenir, University of Bern
Samantha Besson,
(4.11.2023) | Conference
The Representative Turn in Global Democracy, University Pompeu Fabra, Barcelona
Samantha Besson,
(18.10.2023) | Conference
Le droit de l'homme à participer à la science: enjeux institutionnels en Suisse et dans le monde
Samantha Besson,
Inaugural conference, Swiss Academies of Human and Social Sciences, Bern
(22.9.2023) | Conference
La représentation démocratique internationale, Seminar, Observatoire de la représentation, Paris
Samantha Besson,
(5.7.2023) | Conference
From Multiple Sovereignty to Multiple Representation by International Organizations, Collège de France, Paris
Samantha Besson,
(23.6.2023) | Conference
Democratic Representation in International Organizations, annual Conference, Collège de France, Paris
Samantha Besson,
(22.6.2023) | Conference
Democratic Representation in, through and by International Organizations, An Introduction, Collège de France, Paris
Samantha Besson,
(22.6.2023) | Conference
The Multiple International Representation System, Conference, Tokyo University College
(29.5.2023) | Conference
La distinction public/privé et le droit international, Conference and Seminar, University of Lausanne
(16.5.2023) | Conference
La représentation démocratique internationale, Conference, University of Lausanne
(9.5.2023) | Conference
The 'Human Right to Science' qua Right to Participate in Science, University of Edinburgh
Samantha Besson,
(1.5.2023) | Conference
Democratic Representation in and by International Organizations, Colloquium, Center for Transnational Legal Studies, King's College, London
(20.4.2023) | Conference
Historia magistra pacis? Zur Relevanz des Westfälischen Friedens im 21. Jahrundert
Samantha Besson,
(23.3.2023) | Conference
Reply to Michael Rohrschneider, 'Historia magistra pacis? Zur Relevanz des Westfälischen Friedens im 21. Jahrundert', Deutsches Historisches Institut Paris
Samantha Besson,
(23.3.2023) | Conference
Le droit international des organisations régionales: premières leçons des travaux du groupe de travail ILA, Assemblée générale de la branche française de l'ILA, Paris
Samantha Besson,
(26.1.2023) | Conference
La science, un droit de l'Homme?
Samantha Besson,
Soirées de l'Administrateur, Collège de France, Paris
(17.1.2023) | Conference
Droit constitutionnel européen : Précis de droit et résumés de jurisprudence: 2nd edn, lxx-592 pages (1st edn: 2019)
Samantha Besson (Stämpfli, 2023)
| Book
The Law of International Organizations
Samantha Besson,
(2023) | Conference
Extraterritoriality in International Human Rights Law: Back to the Jurisdictional Drawing Board, in Parrish, A. and Ryngaert, C. (eds), Research Handbook on Extraterritoriality in International Law, London, Elgar 2023, 270-292
Samantha Besson (2023)
| Book chapter
L'en-Droit du monde, in Courtet, C., Besson, M., Lavocat, F. and Lecercle, F. (eds), Contes, mondes et récits, Paris: Editions CNRS 2023, 27-39
Samantha Besson (2023)
| Book chapter
Consenting to International Law, An Introduction, in Besson, S. (ed.), Consenting to International Law, 2023, 1-27
, in ASIL International Legal Theory Series, Cambridge University Press 2023, 1-27
Samantha Besson (2023)
| Book chapter
Human Rights as Transnational Constitutional Law, in Lang, A. and Wiener, A. (eds), Handbook on Global Constitutionalism, London: Edward Elgar 2023, 331-346 (revised edition of the 2017 piece).
Samantha Besson (2023)
| Book chapter
Consenting to International Law
Samantha Besson (2023)
| Book chapter
International Cooperation under the Human Right to Science: What and Whose Duties? with Katja Achermann (2023)
Fontiers in Sociology, 8 1273984, doi: 10.3389/fsoc.2023.1273984 (2023) | Journal article
The International Law of Regional Organizations, An Introduction, Closed Workshop, Fondation Hugot du Collège de France, Paris
Samantha Besson,
(8.12.2022) | Conference
Introduction: Anticipation under the Human Right to Science, Concepts and Stakes, GESDA Workshop Anticipation Duties and Responsibilities under the Human Right to Science, Brocher Foundation, Geneva
(29.11.2022) | Conference
Democratic Representation within International Organizations. From International Good Governance to International Good Government, 2022 19 International Organizations Law Review 489-527
Samantha Besson, Law Review (2022) | Journal article
La représentation démocratique multiple au sein de l’OMS’, Démocratiser l’espace-monde Conference, University Paris II Panthéon Assas, 20-21 October 2022
(20.10.2022) | Conference
The Human Right to Science qua Social Right, Social Human Rights and the State Online Lecture Series
(19.10.2022) | Conference
Scientific Anticipation under the Human Right to Science’, GESDA Global Summit, Geneva, 13 October 2022
(13.10.2022) | Conference
L'en-Droit du monde, Rencontres Recherches et création Contes, mondes et récits, Festival d'Avignon, Avignon
(12.7.2022) | Conference
Due Diligence in International Law, UN Audiovisual Library of International Law, Lecture Series
(29.6.2022) | Conference
From Equal State Consent to Equal Public Participation - Multiple Representation and Sovereignty in International Organizations, with José Luis Marti, Consenting to International Law Conference, Collège de France, Paris
(24.6.2022) | Conference
Consenting to International Law, An Introduction, Consenting to International Law Conference, Collège de France, Paris
(23.6.2022) | Conference
Public and Private International Law - Genealogy of an Uneasy Opposition and Risks of the New Confluence, Seminar, Max Planck Institute of Comparative Law and Private International Law, Hamburg
(18.5.2022) | Conference
The Public/Private Relation and International Law, Thomas Franck Lecture, Berlin-Potsdam Research Group International Rule of Law: Rise or Decline?, Freie Universität, Berlin
(16.5.2022) | Conference
Public International Law against Privatization, Seminar, Berlin-Postdam Research Group International Rule of Law: Rise or Decline, Freie Universität, Berlin
(9.5.2022) | Conference
L'égalité pour une paix durable/Equality for Lasting Peace
ESIL Newsletter (2022) | Journal article
Justifications of Human Rights
, in International Human Rights Law, 4th edn.
(2022)
| Book chapter
Theorizing International Responsibility Law, An Introduction
, in Theories of International Responsibility Law
(2022)
| Book chapter
Quand l’Europe invente, s’invente et se réinvente. Une introduction (352 pages)
, in Inventer l'Europe. Actes du Colloque de rentrée 2021 du Collège de France
Samantha Besson (2022)
| Book chapter
L’égalité des Etats membres de l’Union européenne : un nouveau départ en droit international de l’organisation des Etats ?’, in Dubout, E. (ed.), L’égalité des Etats membres de l’Union européenne, Brussels: Bruylant, 2022, 263-298.
, in L'égalité des Etats membres de l'Union européenne
Samantha Besson (2022)
| Book chapter
L'égalité des Etats membres de l'UE: leçons en droit international de l'organisation des Etats
Université Paris II
(29.10.2021) | Conference
Conclusions
(21.10.2021) | Conference
Extraterritoriality and Human Rights
(17.9.2021) | Conference
Introduction
Collège de France, Paris et Collège Belgique, Brussels
(17.9.2021) | Conference
Introduction
Collège de France, Paris et Collège Belgique, Brussels
(17.9.2021) | Conference
Theorizing International Responsibility Law, An Introduction
Collège de France
(25.6.2021) | Conference
A Good Government Standard for International Organizations. With a Special Emphasis on Democratic Representation
Centre for Advances Study
(1.6.2021) | Conference
Disagreement, Consent and Consensus about Human Rights. A Democratic Reading of International Human Rights law
GOODPOL Disagreement and Human Rights Workshop
(27.5.2021) | Conference
Le droit international aux prises avec les inégalités politiques
Ecole de droit de la Sorbonne Doctoral Seminar on Les inégalités et leurs manifestations en droit international et européen
(7.4.2021) | Conference
Due Diligence in International Law: Main Tenets from the Eponymous 2020 Hague Lecture
University of Westminster
(17.3.2021) | Conference
Passeports européens à vendre? Les enjeux du débat en droit international et européen de la citoyenneté
Séminaire Politiques migratoires, Collège de France, Paris
(1.2.2021) | Conference
Due Diligence and the Extraterritorial Application of Human Rights
Hebrew University, Jerusalem
(19.1.2021) | Conference
Reconstruire le droit international à partir des organisations régionales/Reconstructing International Law starting from Regional Organizations
Revue européenne du droit (2021) | Journal article
Cities as Democratic Representatives in International Law-Making
, in Research Handbook on International Law and Cities
(2021), ISBN: 978 1 78897 327 4
| Book chapter
Article 5(4) Cst. : L’Etat régi par le droit international
, in Commentaire romand de la Constitution suisse
(2021), ISBN: 978-3-7190-4000-0
| Book chapter
COVID-19 et le « moment politique » de l’OMS
, in Covid-19. Tour du monde
(2021), ISBN: 978-2-84578-725-4
| Book chapter
Reconstruire l’ordre institutionnel international
, in Reconstruire l’ordre institutionnel international
Samantha Besson (2021), ISBN: 9782722605770
| Book chapter
Du droit de civilisation européen au droit international des civilisations: instaurer un monde des régions
Swiss Review of International and European Law 31:3 (2021) | Journal article
Le droit international des civilisations - Ou comment instituer leur concentration
, in Civilisation(s). Questionner l'identité et la diversité
(2021)
| Book chapter
The Public of International Law: a Farewell to Functions
American Journal of International Law (2021) | Journal article
Passeport européens à vendre? Arguments de droit international et européen contre les programmes d'acquisition de la citoyenneté par investissement
Annuaire Suisse de Droit Européen (2021) | Journal article
Reconstruire l’ordre institutionnel international
Inaugural Lecture on the Chair Droit international des institutions
(3.12.2020) | Conference
Le droit international des civilisations – Ou comment instituer leur concertation
Collège de France, Paris
(22.11.2020) | Conference
Sovereign States and their International Institutional Order
Samantha Besson, Jus Cogens (2020) | Journal article
Les droits de l’homme au service du climat : forces et faiblesses
Collège de France, Paris
(21.9.2020) | Conference
Politique de santé et santé du politique à l’OMS à l’ère du coronavirus
Collège de France, Paris
(9.9.2020) | Conference
Due Diligence and the Extraterritorial Application of Human Rights
Asser Institute Seminar, The Hague
(17.1.2020) | Conference
La Due Diligence en droit international
(Brill/Nijhoff: Leiden/Boston, 2020)
| Book
Traités internationaux. Recueil de textes de droit international public
(Berne: Stämpfli , 2020)
| Book
Concerter les civilisations. Mélanges en l’honneur d’Alain Supiot
(Paris: Seuil , 2020)
| Edited book
Sovereign States and their International Institutional Order. Carrying Forward Dworkin’s Work on the Political Legitimacy of International Law
Jus Cogens (2020) | Journal article
COVID-19 and the WHO’s Political Moment
EJIL Talk! (2020) | Journal article
L’autorité légitime du droit international comparé : Quelques réflexions autour du monde et du droit des gens de Vico
, in Concerter les civilisations. Mélanges en l’honneur d’Alain Supiot
(2020)
| Book chapter
'La Due Diligence en droit international’, Special Course, The Hague Academy of International Law
(2020) | Conference
The Holders of Human Rights: The Bright Side of Human Rights?
, in The Oxford Handbook of Global Justice
Besson, Samantha, ed. by Brooks, T. (Oxford University Press, 2020)
| Book chapter
Due Diligence and Extraterritorial Human Rights Obligations - Mind the Gap!
Besson, Samantha, ESIL Reflections (2020) | Journal article
Que fait l'Europe ? Ce que le Coronavirus nous dit de l'état de l'Union européenne
Besson, Samantha, (2020) | Working paper
The Human Right to Democracy in International Law - Coming to Moral Terms with an Equivocal Legal Practice
, in The Cambridge Handbook of New Human Rights. Recognition, Novelty, Rhetoric
Besson, Samantha, ed. by Andreas von Arnauld and Kerstin von der Decken and Mart Susi (Cambridge University Press, 2020)
| Book chapter
Les droits de l’homme au service du marché ? Critique et réforme du droit international et européen des droits de l’homme en vue d’un renouveau démocratique
Annuaire suisse de droit européen (2020) | Journal article
Review of Francesco Lusa Bordin’s The Analogy between States and International Organizations
(2020) | Review
The Political Legitimacy of International Law: Sovereign States and their International Institutional Order. Carrying Dworkin’s Later Work on International Law Forward
Edinburgh Law School
(18.11.2019) | Conference
Comparative Law and Human Rights
, in The Oxford Handbook of Comparative Law
Besson, Samantha, ed. by Reimann and Mathias and Zimmermann and Reinhard (Oxford University Press, 2019)
| Book chapter
Review of José E. Alvarez. The Impact of International Organizations on International Law
Besson, Samantha, European Journal of International Law (2019) | Journal article
Völkerrecht/ Droit international public - Aide mémoire
Besson, Samantha and Breitenmoser, Stephan and Sassoli, Marco and Ziegler, Andreas R. (Dike, 2019)
| Book
Droit international public : Précis de droit et résumés de jurisprudence
Besson, Samantha (Stämpfli, 2019)
| Book
Droit constitutionnel européen : Précis de droit et résumés de jurisprudence
Besson, Samantha (Stämpfli, 2019)
| Book
Article 2 : The Right to Non-Discrimination
, in The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary
Besson, Samantha and Kleber, Eleonor, ed. by Tobin, John and Alston, Philip (Oxford University Press, 2019)
| Book chapter
Why and What (State) Jurisdiction: Legal Plurality, Individual Equality and Territorial Legitimacy
, in The Challenge of Inter-Legality
Besson, Samantha, ed. by Jan Klabbers and Gianluigi Palombella (Cambridge University Press, 2019)
| Book chapter
Investment Citizenship and Democracy in a Global Age: Towards a Democratic Interpretation of International Nationality Law
Besson, Samantha, Swiss Review of International and European Law (2019) | Journal article
In What Sense are Economic Rights Human Rights ? Departing from their Naturalistic Reading in International Human Rights Law
, in Economic Liberties and Human Rights
Besson, Samantha, ed. by Jahel Queralt and Bas van der Vossen (Routledge, 2019)
| Book chapter
International courts and the jurisprudence of statehood
Besson, Samantha, Transnational Legal Theory (2019) | Journal article
Le consentement en droit
(Zürich: Schulthess , 2018)
| Edited book
Community Interests in the Identification of International Law – With a Special Emphasis on Treaty Interpretation and Customary Law Identification
, in Community Interests across International Law
(2018)
| Book chapter
‘International Courts and the Jurisprudence of Statehood’, PluriCourts Annual Lecture, University of Oslo
(2018) | Conference
International Human Rights Law and Mirrors
Besson, Samantha, ESIL Reflections (2018) | Journal article
Community Interests in International Law : Whose Interests Are They and How Should We Best Identify Them?
, in Community Interests Across International Law
Besson, Samantha, ed. by Benvenisti and Eyal and Nolte and Georg (Oxford University Press, 2018)
| Book chapter
Community Interests in the Identification of International Law - With a Special Emphasis on Treaty Interpretation & Customary Law Identification
, in Community Interests Across International Law
Besson, Samantha, ed. by Benvenisti and Eyal and Nolte and Georg (Oxford University Press, 2018)
| Book chapter
Human Rights and Justification : A Reply to Mattias Kumm
, in Human Rights : Moral or Political?
Besson, Samantha, ed. by Etinson, Adam (Oxford University Press, 2018)
| Book chapter
The Influence of the Two Covenants on States Parties Across Regions : Lessons for the Role of Comparative Law and of Regions in International Human Rights Law
, in The Human Rights Covenants at 50. Their Past, Present, and Future
Besson, Samantha, ed. by Moeckli and Daniel and Keller and Helen and Heri and Corina (Oxford University Press, 2018)
| Book chapter
Concurrent Responsibilities under the European Convention on Human Rights. The Concurrence of Human Rights Jurisdictions, Duties, and Responsibilities
, in The European Convention on Human Rights and General International Law
Besson, Samantha, ed. by van Aaken and Anne and Motoc and Iulia (Oxford University Press, 2018)
| Book chapter
La responsabilité solidaire des États et/ou des organisations internationales : une institution négligée
, in Face à l’irresponsabilité : la dynamique de la solidarité
Besson, Samantha, ed. by Supiot, Alain (Collège de France, 2018)
| Book chapter
Legitimate Actors of International Law-Making : Towards a Theory of International Democratic Representation
Besson, Samantha and Marti, Jose Luis, Jurisprudence (2018) | Journal article
The Oxford Handbook of the Sources of International Law
D’aspremont, Jean and Besson, Samantha (Oxford University Press, 2017)
| Book
Comparing Comparative Law
(Zürich: Schulthess , 2017)
| Edited book
International Responsibility. Essays in Law, History and Philosophy
(Zürich: Schulthess , 2017)
| Edited book
Individual and State Liability for an International Organization’s Responsibility – The Challenge of Fairness Unveiled
Italian Journal of Legal Philosophy (2017) | Journal article
Justifications of Human Rights
, in International Human Rights Law
(2017)
| Book chapter
EU General Principles qua EU Customary Law
, in General Principles of EU Law
(2017)
| Book chapter
Préface
, in Comparing comparative law
Besson, Samantha and Heckendorn Urscheler, Lukas and Jubé, Samuel, ed. by Besson and Samantha and Heckendorn Urscheler and Lukas and Jubé and Samuel (Schulthess, 2017)
| Book chapter
Introduction
, in Comparing comparative law
Besson, Samantha and Heckendorn Urscheler, Lukas and Jubé, Samuel, ed. by Besson and Samantha and Heckendorn Urscheler and Lukas and Jubé and Samuel (Schulthess, 2017)
| Book chapter
L'Etat, cet angle mort du droit international
Besson, Samantha, Quid? : Fribourg law review (2017) | Journal article
General Principles and Customary Law in the EU Legal Order
, in General Principles of Law : European and Comparative Perspectives
Besson, Samantha, ed. by Vogenauer and Stefan and Weatherill and Stephen (Hart Publishing, 2017)
| Book chapter
International Legal Theory qua Practice of International Law
, in International Law as a Profession
Besson, Samantha, ed. by d’Aspremont and Jean and Gazzini and Tarcisio and Nollkaemper and André and Werner and Wouter (Cambridge University Press, 2017)
| Book chapter
Human Rights in Relation. A Critical Reading of the ECtHR's Approach to Conflicts of Rights
, in When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights : Conflict or Harmony?
Besson, Samantha, ed. by Smet and Stijn and Brems and Eva (Oxford University Press, 2017)
| Book chapter
The Sources of International Human Rights Law : How General is General International Law?
, in The Oxford Handbook of the Sources of International Law
Besson, Samantha, ed. by Besson and Samantha and d’Aspremont and Jean (Oxford University Press, 2017)
| Book chapter
Sources of international human rights law
, in The Oxford Handbook of the Sources of International Law
Besson, Samantha and Simma, Bruno, ed. by Besson and Samantha and d’Aspremont and Jean (Oxford University Press, 2017)
| Book chapter
Law Beyond the State: A Reply to Liam Murphy
Besson, Samantha, European Journal of International Law (2017) | Journal article
Security and Human Rights : Mind the Balance ! On Security in International Human Rights Law and the Dangers of the Normalization of Emergency
Besson, Samantha, Quid? Fribourg law review (2017) | Journal article
International Responsibility: An Introduction
, in International responsibility : essays in law, history and philosophy
Besson, Samantha, ed. by Besson, Samantha (Schulthess, 2017)
| Book chapter
The Sources of International Law : An Introduction
, in The Oxford Handbook of the Sources of International Law
Besson, Samantha and d’Aspremont, Jean, ed. by Besson and Samantha and d’Aspremont and Jean (Oxford University Press, 2017)
| Book chapter
Human Rights as Transnational Constitutional Law
, in Handbook on Global Constitutionalism
Besson, Samantha, ed. by Anthony F. Lang and Antje Wiener (Edward Elgar Publishing, 2017)
| Book chapter
State and Individual Secondary Liability in Case of International Organizations' Responsibility. The Challenge of Fairness Unveiled
Besson, Samantha, Rivista del filosofia del diritto (Journal of legal Philosophy) (2017) | Journal article
L’évolution du contrôle européen: vers une subsidiarité toujours plus subsidiaire ?
, in La Cour européenne des droits de l’homme: une confiance nécessaire pour une autorité renforcée
(2016)
| Book chapter
Le droit de la famille sous l'angle des droits de l'homme
Besson, Samantha, Swiss Academies Reports (2016) | Journal article
Human Rights Adjudication as Transnational Adjudication: A Peripheral Case of Domestic Courts as International Law Adjudicators
, in International Law and...
Besson, Samantha, ed. by Reinisch and August and Footer and Mary E. and Binder and Christina (Hart Publishing, 2016)
| Book chapter
Moral Philosophy and International Law
, in The Oxford Handbook of the Theory of International Law
Besson, Samantha, ed. by Orford and Anne and Hoffmann and Florian and Clark and Martin (Oxford University Press, 2016)
| Book chapter
L'Evolution du contrôle européen : vers une subsidiarité toujours plus subsidiaire
, in La Cour européenne des droits de l’homme : une confiance nécessaire pour une autorité renforcée
Besson, Samantha, ed. by Touzé, Sébastien (Pedone, 2016)
| Book chapter
Traités internationaux. Recueil de textes de droit international public
Besson, Samantha and Ziegler, Andreas R. (Stämpfli, 2016)
| Book
Droit international public : Abrégé de cours et résumés de jurisprudence
Besson, Samantha (Stämpfli, 2016)
| Book
Droit constitutionnel européen : Abrégé de cours et résumés de jurisprudence
Besson, Samantha (Stämpfli, 2016)
| Book
L’application extra-territoriale des droits de l’homme internationaux en pratique : juridictions concurrentes, obligations conjointes et responsabilités partagées
, in Droit des frontières internationales – The law of international borders
Besson, Samantha (Pedone, 2016)
| Book chapter
State Consent and Disagreement in International Law-Making. Dissolving the Paradox
Besson, Samantha, Leiden Journal of International Law (2016) | Journal article
Subsidiarity in International Human Rights Law. What is Subsidiary about Human Rights ?
Besson, Samantha, The American Journal of Jurisprudence (2016) | Journal article
La pratique suisse relative à la détermination du droit international coutumier
Besson, Samantha and Ammann, Odile (2016)
| Book
Legal Human Rights Theory
, in A Companion to Applied Philosophy
Besson, Samantha, ed. by Kasper Lippert-Rasmussen and Kimberley Brownlee and David Coady (Wiley Blackwell, 2016)
| Book chapter
L’Union européenne et le droit international
(Zürich: Schulthess, 2015)
| Edited book
The Human Right to Science
European Journal of Human Rights (2015) | Journal article
'International Law’s Relative Authority’, Review of Nicole Roughan’s Authorities. Conflicts, Cooperation and Transnational Legal Theory
(2015) | Review
‘The Sources of Human Rights’, ‘Or’ Emet Annual Lecture, Osgoode Hall Law School, York University
(2015) | Conference
Human Rights Waivers and the Right to Do Wrong under the European Convention on Human Rights (ECHR)
, in Liber amicorum Dean Spielmann. Mélanges en l‘honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann
Besson, Samantha, ed. by Casadevall, Josep (Wolf Legal Publishers, 2015)
| Book chapter
L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme après l'avis 2/13
, in Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2014/2015 / Annuaire suisse de droit européen 2014/2015
Besson, Samantha, ed. by Epiney and Astrid and Kern and Markus and Hehemann and Lena (Schulthess, 2015)
| Book chapter
Introduction : mapping the issues
Besson, Samantha, Journal européen des droits de l’homme = European Journal of human rights (2015) | Journal article
Science without Borders and the Boundaries of Human Rights : Who Owes the Human Right to Science ? /Une science sans frontière face aux frontières des droits de l'homme : qui est débiteur du droit de l'homme à la science ?
Besson, Samantha, Journal européen des droits de l’homme = European Journal of human rights (2015) | Journal article
Human Rights and Constitutional Law : Patterns of Mutual Validation and Legitimation
, in Philosophical Foundations of Human Rights
Besson, Samantha, ed. by Cruft and Rowan and Liao and Matthew and Renzo and Massimo (Oxford University Press, 2015)
| Book chapter
International Law's Relative Authority : Review of Nicole Roughan's Authorities, Conflicts, Cooperation and Transnational Legal Theory
Besson, Samantha, Jurisprudence. An International Journal of Legal and Political Thought (2015) | Journal article
The Bearers of Human Rights Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution
Besson, Samantha, Social Philosophy and Policy (2015) | Journal article
Egalité et non-discrimination en droit international et européen
(Zürich: Schulthess , 2014)
| Edited book
La Convention européenne des droits de l’homme et les cantons
(Zürich: Schulthess , 2014)
| Edited book
L’interprétation des accords bilatéraux Suisse-UE – Une lecture de droit international
Annuaire de droit européen – Jahrbuch für Europarecht (2014) | Journal article
La structure et la nature des droits de l’homme
, in Introduction aux droits de l’homme
(2014)
| Book chapter
International Human Rights and Political Equality – Some Implications for Global Democracy
, in Equality in Transnational and Global Democracy
(2014)
| Book chapter
Legal Philosophical Issues of International Adjudication – Getting over the amour impossible between international law and adjudication
, in The Oxford Handbook of International Adjudication
(2014)
| Book chapter
‘An Uncompromising Compromising Mindset’, Review of Amy Gutmann’s and Dennis Thompson’s The Spirit of Compromise: Why Governing Demands It and Campaigning Undermines It
(2014) | Review
La vulnerabilité et la structure des droits de l'homme : L'exemple de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
, in La vulnérabilité saisie par les juges en Europe
Besson, Samantha, ed. by Laurence Burgorgue-Larsen (Pedone, 2014)
| Book chapter
Structure et nature des droits de l'homme
, in Introduction aux droits de l’homme
Besson, Samantha, ed. by Hertig Randall and Maya and Hottelier and Michel (Schulthess, 2014)
| Book chapter
Le droit de vote des expatriés, le consensus européen et la marge d'appréciation des Etats (Cour eur. dr. h., arrêt Sitarapoulos et Giakamapoulos c. Grèce, 15 mars 2012)
Besson, Samantha and Graf-Brugère, Anne-Laurence, Revue trimestrielle des droits de l’homme (2014) | Journal article
Le droit international et européen des droits de l'homme et la forme politique fédérale. Je t'aime, moi non plus
Samantha Besson (2014)
| Book chapter
European Human Rights Pluralism : Notion and justification
, in Transnational law rethinking european law and legal thinking.
Besson, Samantha, ed. by Miguel Maduro and Kaarlo Tuori and Suvi Sankari (Cambridge University Press, 2014)
| Book chapter
Commentaire des Articles 3, 5, 8, 12, 13, 14 et 16 CEDH et du Protocole No 7, CEDH
, in Code annoté de droit des migrations
Besson, Samantha and Kleber, Eleonor, ed. by Amarelle, C. and Nguyen, M.S. (Schulthess, 2014)
| Book chapter
L'interprétation des accords bilatéraux Suisse-UE : une lecture de droit international
, in Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2013/2014 / Annuaire suisse de droit européen 2013/2014
Besson, Samantha and Ammann, Odile, ed. by Epiney and Astrid and Diezig and Stefan (Schulthess, 2014)
| Book chapter
Amy Gutmann and Dennis Thompson, The Spirit of Compromise. Why Governing Demands It and Campaigning Undermines It, Princeton: Princeton University Press 2012, 256 pp.
Besson, Samantha (2014) | Review
Völkerrecht/Droit international public – Aide-mémoire
(Zürich: Dike , 2013)
| Book
Le juge en droit international et européen
(Zürich: Schulthess , 2013)
| Edited book
Fédéralisme et droits de l’homme: une introduction thématique
, in La Convention européenne des droits de l’homme et les cantons – Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Kantone
(2013)
| Book chapter
Armut, Migration und Staatsbürgerschaft - Poverty, Migration and Citizenship – Respondenz zu Ayelet Shachars Mosse-Lecture
, in Citizenship – Mosse Lectures 2011-2012
(2013)
| Book chapter
Justifications of human rights
, in International Human Rights Law
Besson, Samantha, ed. by Moeckli and Daniel and Shah and Sangeeta and Sandesh and Sivakumaran (Oxfond University Press, 2013)
| Book chapter
The legitimate authority of international human rights
, in The Legitimacy of International Human Rights Regimes
Besson, Samantha, ed. by Føllesdal and Andreas and Karlsson Schaffer and Johan and Ulfstein and Geir (Cambridge University Press, 2013)
| Book chapter
International Human Rights and Political Equality : Some Implications for Global Democracy
, in Political Equality in Transnational Democracy
Besson, Samantha, ed. by Erman and Eva and Näsström and Sofia (Palgrave Macmillan, 2013)
| Book chapter
The Allocation of Anti-poverty Rights Duties - Our Rights, but Whose Duties ?
, in Poverty and the International Economic Legal System : Duties to the World’s Poor
Besson, Samantha, ed. by Nadakavukaren Schefer K. (Cambridge University Press, 2013)
| Book chapter
Legal Philosophical Issues of International Adjudication - Getting over the amour impossible between international law and adjudication
, in The Oxford Handbook of International Adjudication
Besson, Samantha, ed. by Romano and Cesare P. R. and Alter and Karen J. and Shany and Yuval (Oxfond University Press, 2013)
| Book chapter
Introduction
, in Le juge en droit européen et international / the Judge in European and International Law
Besson, Samantha and Niang, Fatimata, ed. by Besson and Samantha and Ziegler and Andreas R. (Schulthess, 2013)
| Book chapter
The Egalitarian Dimension of Human Rights
Besson, Samantha, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, ARSP. Beiheft (2013) | Journal article
The Law in Human Rights Theory
Besson, Samantha, Zeitschrift für Menschenrechte - Journal for Human Rights (2013) | Journal article
De quelques considérations philosophiques sur la justice internationale. Ou comment dépasser l'amour impossible entre droit international et justice internationale
, in Le juge en droit européen et international / The Judge in European and International Law
Besson, Samantha, ed. by Besson and Samantha and Ziegler and Andreas R. (Schulthess, 2013)
| Book chapter
(Dés)ordres juridiques européens
(Zürich: Schulthess , 2012)
| Edited book
Human Rights Theory and Human Rights History: A Tale of Two Odd Bedfellows
Ancilla Juris (2012) | Journal article
International Judges’ Function(s) between Dispute-Settlement and Law-Enforcement – From International Law without Courts to International Courts without Law
Loyola International and Comparative Law Review (2012) | Journal article
The Truth about Legal Pluralism. Nico Krisch Beyond Constitutionalism, The Pluralist Structure of Postnational Law
Besson, Samantha, European Constitutional Law Review (2012) | Journal article
Françoise Tulkens on Human Rights' Restrictions
Besson, Samantha, Strasbourg Observers (2012) | Journal article
Internationale Verträge. Textsammlung in Völkerrecht
Besson, Samantha and Ziegler, Andreas R. (Stämpfli, 2012)
| Book
Sovereignty
, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law
Besson, Samantha, ed. by Wolfrum, Rüdiger (Oxfond University Press, 2012)
| Book chapter
Introduction
, in (Dés)ordres juridiques en Europe. European legal (dis)order
Besson, Samantha and Gätcher-Alge, Marie-Louise, ed. by Levrat and Nicolas and Besson and Samantha (Schulthess, 2012)
| Book chapter
The Right to Have Rights : From Human Rights to Citizens' Rights and Back
, in Hannah Arendt and the Law
Besson, Samantha, ed. by Goldoni and Marco and McCorkindale and Chris (Hart Publishing, 2012)
| Book chapter
Evolutions in Non-Discrimination Law within the ECHR and the ESC Systems: "It Takes Two to Tango in the Council of Europe"
Besson, Samantha, The American Journal of Comparative Law (2012) | Journal article
The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to
Besson, Samantha, Leiden Journal of International Law (2012) | Journal article
The Philosophy of International Law - Edited by Samantha Besson and John Tasioulas
STEPHEN ELIOT SMITH, Journal of Applied Philosophy (2011) | Journal article
La Cour européenne des droits de l’homme après le Protocole 14 – Premier bilan et perspectives
(Zürich: Schulthess , 2011)
| Edited book
Les principes en droit européen
(Zürich: Schulthess , 2011)
| Edited book
‘How to Theorise Law in a Transnational Context’, Review of Detlef von Daniels’ The Concept of Law from a Transnational Perspective
(2011) | Review
The Human Rights Competence in the EU. The State of the Question after Lisbon
, in Human Rights and Taxation in Europe and the World
Besson, Samantha, ed. by Poiares Maduro and Miguel and Pistone and Pasquale and Kofler and Georg (IBFD, 2011)
| Book chapter
International Judges as Dispute-Settlers and Law-Enforcers : From International Law Without Courtsto International Courts Without Law
Besson, Samantha, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review (2011) | Journal article
How to Theorise Law in a Transnational Context : Review of Detlef von Daniels' The Concept of Law from a Transnational Perspective
Besson, Samantha, Transnational Legal Theory (2011) | Journal article
L'effectivité des droits de l'homme : du devoir être, du pouvoir être et de l'être en matière de droits de l'homme
, in L’Homme et son droit. Mélanges en l’honneur de Marco Borghi à l’occasion de son 65e anniversaire
Besson, Samantha, ed. by Zufferey and Jean-Baptiste and Dubey and Jacques and Previtali and Adriano (Schulthess, 2011)
| Book chapter
The human right to democracy : a moral defence with a legal nuance
, in Definition and development of human rights and popular sovereignty in Europe
Besson, Samantha (Éditions du Conseil de l’Europe, 2011)
| Book chapter
International Legality - A Response to Hathaway & Shapiro
Besson, Samantha, (2011) | Working paper
Introduction
, in Les principes en droit européen / Principles in European Law
Besson, Samantha and Gätcher-Alge, Marie-Louise, ed. by Besson and Samantha and Pichonnaz and Pascal (Schulthess, 2011)
| Book chapter
General Principles in International Law : Whose Principles?
, in Les principes en droit européen / Principles in European Law
Besson, Samantha, ed. by Besson and Samantha and Pichonnaz and Pascal (Schulthess, 2011)
| Book chapter
European human rights, supranational judicial review and democracy : thinking outside the judicial box
, in Human rights protection in the European legal order : The interaction between the European and the national courts
Besson, Samantha, ed. by Popelier and Patricia and Van de Heyning and Catherine and Van Nuffel and Piet (Intersentia, 2011)
| Book chapter
Gruppen, Rechte und Konflikte : Ein Kommentar zu M. Nussbaumm - Religion, Kultur und die Gleichstellung der Geschlechter
, in Humanismus : Sein kritisches Potential für Gegenwart und Zukunft
Besson, Samantha, ed. by Holderegger and Adrian and Weichlein and Siegfried and Zurbuchen and Simone (Schwabe Verlagsgruppe AG Schwabe Verlag, 2011)
| Book chapter
Human rights and democracy in a global context : decoupling and recoupling
Besson, Samantha, Ethics & Global Politics (2011) | Journal article
The Democratic Legitimacy of WTO Law. On the Dangers of Fast-food Democracy
Besson, Samantha, (2011) | Working paper
L'interprétation en droit européen - Quelques remarques introductives
, in Interprétation en droit européen / Interpretation in European Law
Besson, Samantha and Gätcher-Alge, Marie-Louise, ed. by Besson and Samantha and Levrat and Nicolas and Clerc and Evelyne (Schulthess, 2011)
| Book chapter
The Erga Omnes Effect of Judgments of the European Court of Human Rights : What's in a Name?
, in La Cour européenne des droits de l’homme après le Protocole 14 / The European Court of Human Rights after Protocol 14
Besson, Samantha, ed. by Besson, Samantha (Schulthess, 2011)
| Book chapter
Sovereignty, International Law and Democracy
Besson, Samantha, European Journal of International Law (2011) | Journal article
Human Rights: Ethical, Political... or Legal? First Steps in a Legal Theory of Human Rights
, in The Role of Ethics in International Law
Besson, Samantha, ed. by Donald Earl Childress, III (Cambridge University Press, 2011)
| Book chapter
The Philosophy of International Law
(Oxford: Oxford University Press , 2010)
| Edited book
Theorizing the Sources of International Law
, in The Philosophy of International Law
Besson, Samantha, ed. by Besson and Samantha and Tasioulas and John (Oxford University Press, 2010)
| Book chapter
Human Rights qua Normative Practice. Sui generis or Legal? Review of Charles Beitz's "The Idea of Human Rights"
Besson, Samantha, Transnational Legal Theory (2010) | Journal article
Les effets et l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : le cas de la Suisse
, in EMRK und die Schweiz. Referate der Tagung vom 5. Juni 2009 in Bern / La CEDH et la Suisse. Exposés du séminaire du 5 juin 2009 à Berne
Besson, Samantha (2010)
| Book chapter
Introduction
, in The Philosophy of International Law
Besson, Samantha and Tasioulas, John, ed. by Besson and Samantha and Tasioulas and John (Oxford University Press, 2010)
| Book chapter
Ubi Ius, Ibi Civitas. A Republican Account of the International Community
, in Legal Republicanism : National and International Perspectives
Besson, Samantha, ed. by Samantha Besson and José-Luis Martí (Oxford University Press, 2009)
| Book chapter
Legal Republicanism: National and International
(Oxford: Oxford University Press , 2009)
| Edited book
The Relationship between European and International Law
European Constitutional Law Review (2009) | Journal article
Fundamental Rights and European Private Law
, in European Private Law : A Handbook
Besson, Samantha, ed. by Bussani and Mauro and Werro and Franz (Stämpfli / Carolina Academic Press / Bruylant, 2009)
| Book chapter
Law and Republicanism. Mapping the Issues
, in Legal Republicanism : National and International Perspectives
Besson, Samantha and Marti, José Luis, ed. by Besson and Samantha and Marti and José Luis (Oxford University Press, 2009)
| Book chapter
Sovereignty: from independence to responsibility. On asking the right question in Switzerland
, in Die Schweiz und Europa : Wirtschaftliche Integration und institutionelle Abstinenz
Besson, Samantha (Schulthess, 2009)
| Book chapter
Institutionalising global demoi-cracy
, in Legitimacy, Justice and Public International Law
Besson, Samantha, ed. by Meyer, Lukas H. (Cambridge University Press, 2009)
| Book chapter
European Legal Pluralism after Kadi
Besson, Samantha, European Constitutional Law Review (2009) | Journal article
The Authority of International Law : Lifting the State Veil
Besson, Samantha, Sydney Law Review (2009) | Journal article
Children's Convention (Convention on the Rights of the Child)
, in Encyclopedia of Human Rights
Besson, Samantha and Bourke-Martignoni, Joanna, ed. by Forsythe, David P. (Oxford University Press, 2009)
| Book chapter
Whose Constitution(s) ? International Law, Constitutionalism, and Democracy
, in Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance
Besson, Samantha, ed. by Jeffrey L. Dunoff and Joel P. Trachtman (Cambridge University Press, 2009)
| Book chapter
Des Valeurs pour l'Europe?
(Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant , 2008)
| Edited book
‘The Authority of International Law – Lifting the State Veil’, Julius Stone Annual Lecture, Supreme Court of New South Wales and University of Sydney
(2008) | Conference
Towards European Citizenship
Besson, Samantha and Utzinger, André, Journal of Social Philosophy (2008) | Journal article
How international is the European legal order ? Retracing Tuori's steps in the exploration of European legal pluralism
Besson, Samantha, No Foundations (2008) | Journal article
The Reception Process in Ireland and the United Kingdom
, in A Europe of Rights : The Impact of the ECHR on National Legal Systems
Besson, Samantha, ed. by Keller and Helen and Stone Sweet and Alec (Oxford University Press, 2008)
| Book chapter
The Sovereign, The Investor and the Arbitrator. Why and How to Reform International Investment Arbitration
, in Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier
Besson, Samantha, ed. by Gauch and Peter and Werro and Franz and Pichonnaz and Pascal (Schulthess, 2008)
| Book chapter
Introduction
, in Des valeurs pour l’Europe ? / Values for Europe?
Besson, Samantha and Levrat, Nicolas, ed. by Besson and Samantha and Cheneval and Francis and Levrat and Nicolas (Éditions Academia, 2008)
| Book chapter
Gender Discrimination under EU and ECHR Law : Never Shall the Twain Meet?
Besson, Samantha, Human Rights Law Review (2008) | Journal article
Une Institution nationale des Droits de l'Homme en Suisse : comment, mais surtout pourquoi ?
Besson, Samantha, (2008) | Working paper
Souveränität, Verantwortung und Neutralität. Damit aus der aktiven Neutralität kein Prokrustesbett wird
, in Die Schweizer Neutralität: Beibehalten, umgestalten oder doch abschaffen?
(2007)
| Book chapter
European Citizenship Across Borders
, in Le défi des frontieres : Mélanges En l’honneur de Roland Bieber
Besson, Samantha and Utzinger, André, ed. by Epiney and Astrid and Haag and Marcel and Heinemann and Andreas (Nomos Verlagsgesellschaft, 2007)
| Book chapter
La pluralité d'Etats responsables : vers une solidarité internationale ?
Besson, Samantha, Revue suisse de droit international et de droit européen (2007) | Journal article
The concept of constitution in Europe : Interpretation in lieu of translation
Besson, Samantha, No Foundations (2007) | Journal article
Auf den Weg zur Europäischen Demoi-kratie. Die neuere Rechtsprechung der EuGH zur demokratischen Repräsentation in der EU
, in Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2006/2007 / Annuaire Suisse de droit européen 2006/2007
Besson, Samantha and Utzinger, André, ed. by Epiney and Astrid and Wyssling and Markus (Stämpfli, 2007)
| Book chapter
Future Challenges of European Citizenship. Facing a Wide-Open Pandora's Box
Besson, Samantha and Utzinger, André, European Law Journal (2007) | Journal article
Enforcing the Child's Right to Know Her Origins : Contrasting Approaches Under the Convention on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights
Besson, Samantha, International Journal of Law, Policy and the Family (2007) | Journal article
Europe as a Demoi-cratic Polity
Besson, Samantha, Retfaerd - Nordisk Juridisk Tidsskrift (2007) | Journal article
Deliberative Democracy and Its Discontents – National and International Perspectives
(Aldershot: Ashgate, 2006)
| Edited book
Les droits de l'homme au centre
(Zürich: Schulthess , 2006)
| Edited book
Die Tugend des Konflikts
Rechtsphilosophie (2006) | Journal article
Introduction
, in Deliberative Democracy and Its Discontents
(2006)
| Book chapter
Social Goods, Market Forces and Anti-Discrimination Laws: Comment on Alexander Somek
, in Diversity, Justice and Democracy - Visions and Challenges
(2006)
| Book chapter
Comment humaniser le droit privé sans commodifier les droits de l'homme
, in Droit civil et Convention européenne des droits de l’homme
Besson, Samantha, ed. by Werro, Franz (Schulthess, 2006)
| Book chapter
The many european constitutions and the future of european constitutional theory
Besson, Samantha, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, ARSP. Beiheft (2006) | Journal article
Deliberative demoi-cracy in the European Union. Towards the deterritorialization of democracy
, in Deliberative Democracy and its Discontents
Besson, Samantha, ed. by Besson and Samantha and Marti and José Luis (Ashgate, 2006)
| Book chapter
Human Rights at the Center/Les Droits de l'Homme au Centre. A few introductory remarks/Quelques remarques introductive
, in Human Rights at the Center / Les droits de l’homme au Centre
Besson, Samantha and Hottelier, Michel and Werro, Franz, ed. by Besson and Samantha and Hottelier and Michel and Werro and Franz (Schulthess, 2006)
| Book chapter
Souveraineté, Responsabilité et Neutralité : comment ne pas faire de la neutralité active un lit de Procuste
Besson, Samantha, (2006) | Working paper
Sovereignty in Conflict
, in Towards an ”International Legal Community” ? The Sovereignty of States and the Sovereignty of International Law
Besson, Samantha, ed. by Tierney and Stephen and Warbrick and Colin (British Institute of International and Comparative Law, 2006)
| Book chapter
The European Union and Human Rights : Towards A Post-National Human Rights Institution?
Besson, Samantha, Human Rights Law Review (2006) | Journal article
Das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung - Wege und Auswirkungen der Konkretisierung eines Grundrechts
Revue de droit suisse (2005) | Journal article
'Democracy, Law and Authority', Review of Lukas Meyer, Stanley Paulson and Thomas Pogge (eds), Rights, Culture and the Law: Themes from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz
(2005) | Review
'The Taming of Sovereignty', Review of Neil Walker (ed.), Sovereignty in Transition
(2005) | Review
Democracy, Law and Authority, Review of Lukas Meyer, Stanley Paulson and Thomas Pogge (eds), Rights, Culture and the Law: Themes from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz
Besson, Samantha, Journal of Moral Philosophy (2005) | Journal article
The Taming of Sovereignty - A Review of Neil Walker (ed.), Sovereignty in Transition
Besson, Samantha, International Journal of Constitutional Law (2005) | Journal article
The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child
Besson, Samantha, International Journal of Children’s Rights (2005) | Journal article
La constitution de la société civile
Besson, Samantha, Revue Fribourgeoise de Jurisprudence (2005) | Journal article
The Morality of Conflict. Reasonable Disagreement and the Law
Besson, Samantha (Hart Publishing, 2005)
| Book
Deconstructing Hart: A Review of Lacey's A Life of H.L.A. Hart (2004)
Besson, Samantha (2005) | Review
La légitimité de l'arbitrage international d'investissement
Besson, Samantha, (2005) | Working paper
The Paradox of Democratic Representation. On Whether and How Disagreement should be Represented
, in The theory and practice of legislation : essays in legisprudence
Besson, Samantha, ed. by Wintgens, Luc J. (Ashgate, 2005)
| Book chapter
Sovereignty in conflict
European Integration online Papers (2004) | Journal article
From European Integration to European Integrity : Should European Law Speak with Just One Voice ?
Besson, Samantha, European Law Journal (2004) | Journal article
Les obligations positives de protection des droits fondamentaux. Un essai en dogmatique comparative
Revue de Droit Suisse (2003) | Journal article
'Jeremy Bentham et le droit constitutionnel by Guillaume Tusseau', Review
(2003) | Review
Human Rights, Institutional Duties and Cosmopolitan Responsibilities : Review of Thomas Pogge's World Poverty and Human Rights
Besson, Samantha, Oxford Journal of Legal Studies (2003) | Journal article
La souveraineté coopérative en Europe. Ou comment la Suisse pourrait être à la fois européenne et souveraine
, in La Suisse saisie par l’Union européenne. Thèmes choisis sur le droit et les politiques de l’UE
Besson, Samantha, ed. by Balmelli, Tiziano (Éditions Interuniversitaires Suisses, 2003)
| Book chapter
Disagreement and Democracy : From Vote to Deliberation and Back Again? The Move toward Deliberative "Voting Ethics"
, in Law, Politics, and Morality : European Perspectives I. Globalisation, Democracy, and Citizenship - Prospects for the European Union
Besson, Samantha, ed. by Ferrer and Jordi and Iglesias and Marisa (Duncker & Humblot, 2003)
| Book chapter
Post-souveraineté ou simple changement de paradigmes ? Variations sur un concept essentiellement contestable
, in La souveraineté au XXIe siècle
Besson, Samantha, ed. by Tiziano Balmelli and Alvaro Borghi and Pierre-Antoine Hildbrand (Éditions Interuniversitaires Suisses, 2003)
| Book chapter
Review of Jeremy Bentham et le droit constitutionnel, Guillaume Tusseau
Besson, Samantha, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, ARSP. Beiheft (2003) | Journal article
Four Arguments Against Compromising Justice Internally
Besson, Samantha, Oxford Journal of Legal Studies (2003) | Journal article
Plus d'égalité pour les femmes dans les faits : quel rôle pour la nouvelle Constitution cantonale?
Besson, Samantha, Revue Fribourgeoise de Jurisprudence (2002) | Journal article
Paritary Rights for Women in Switzerland: What can one learn from a negative popular verdict?
Jus Gentium (2001) | Journal article
Liberté d’association et égalité de traitement - une dialectique difficile. Etude comparative des modèles théoriques américain et suisse
Revue de Droit Suisse (2001) | Journal article
Le droit par le sexe ou la reconstruction épistémologique et politique selon MacKinnon. Review of Jean-François Gaudreault-Des Biens's "Le sexe et le droit : sur le féminisme juridique de Catherine MacKinnon"
Besson, Samantha, Canadian Journal of Women and the Law (2001) | Journal article
Conflits Constitutionnels en Europe : Une lecture de l'Affaire C-285/98, Tanja Kreil c. République fédérale d'Allemagne
Besson, Samantha, Aktuelle Juristische Praxis. Pratique juridique actuelle (2000) | Journal article
L'égalité horizontale : l'égalité de traitement entre particuliers : des fondements théoriques au droit privé suisse
Besson, Samantha (Editions universitaires, 1999)
| Book
Mesures Positives : le nouvel équilibre asymétrique. Perspectives pour le droit suisse
Besson, Samantha, Aktuelle Juristische Praxis / Pratique juridique actuelle (1999) | Journal article
Discrimination and Freedom of Contract. Philosophical and Economic Foundations of the Law against Racial Discrimination in Employment
Besson, Samantha, International Journal of Discrimination and the Law (1999) | Journal article
L’égalité de traitement entre particuliers en droit communautaire : les fondements
, in L’européanisation du droit privé : Vers un Code civil européen ?
Besson, Samantha (1998)
| Book chapter
'La pratique suisse du droit international 2023', with Lucius Caflisch
Samantha Besson, Swiss Review of International Law 535-585 | Journal article